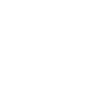Entretien avec Ahmed El Kosheri
I – Les années de formation
Le rapport entre le droit et ma vie personnelle a commencé dès mon enfance. Mon père était médecin et parlait souvent dans les réunions familiales de son propre père qui était juge. Mon grand père est décédé très jeune. Mon père avait des souvenirs d’enfance et trouvait approprié de nous sensibiliser au prestige et à la vie d’un juge durant le premier quart du XXe siècle, ce qui a attiré mon attention. Inconsciemment je rêvais de devenir un jour quelqu’un qui s’occupe de la justice dans la société égyptienne.
20 ans plus tard, ma mère m’a montré des cahiers sur lesquels j’exprimais cette volonté d’aller à la fac de droit. Je n’ai pas hésité à m’inscrire à la fac de droit du Caire à 16 ans après le baccalauréat.. C’était une institution qui avait des traditions profondes et des professeurs qui imposaient, par leur personnalité et leur connaissance, un très grand respect. En tant que jeunes, nous avions beaucoup de difficultés à fouler les mêmes endroits que ces professeurs. On s’arrêtait par respect, par une sorte de pression ; c’était inné. Ils étaient des professeurs, formés en grande partie en France. Ils avaient un grand prestige et une ouverture d’esprit remarquable.
Je suis entré à la fac de droit en octobre 1948 et je me rappelle très bien de mon premier cours sur la production du droit avec le Professeur Heshmat Abustet – co-auteur du livre qu’on étudiait sur l’introduction du droit avec Sanhoury Pasha. Le Professeur Heshmat nous a donné des notions sur la définition du droit et sur le concept de droit. En sa qualité de vice-doyen de la faculté, il avait demandé, avant même la fin de cette première rencontre, s’il y avait, parmi les présents dans l’amphithéâtre, des gens qui avaient été reçu au bac parmi les vingt premiers sur l’ensemble du pays, puisqu’il s’agit d’un concours national. Il désirait les rencontrer dans son bureau après la leçon.
Dix-huit personnes se sont présentées, ce qui a étonné notre cher Professeur. Nous avons découvert par la suite qu’il avait préparé dix exemplaires du livre sur l’introduction de droit pour ces jeunes bacheliers. Il nous a parlé de l’importance de l’étude de droit. Comme pour exprimer sa satisfaction, il a donné à chacun de nous un exemplaire de ce manuel qu’il a composé avec Sanhoury Pasha. C’était la première fois que j’entendais le nom de Sanhoury Pasha, je ne pensais pas que j’allais un jour avoir l’honneur de travailler avec ce grand juriste qui a fait beaucoup de choses non seulement pour l’Egypte mais aussi pour l’ensemble des pays arabes.
Cela démontre à quel point nous nous sentions importants. La faculté de droit, représentait un club d’élites, d’intellectuels qui avaient des idées claires sur leur avenir. Certaines personnes se voyaient déjà ambassadeurs, sénateurs ou ministres ; mais la plupart voulait devenir juges, d’illustres avocats, des gens d’importance dans la société égyptienne. Ces personnes faisaient déjà partie de l’élite égyptienne. La plupart des figures politiques de l’époque étaient des personnes qui avaient fait des études de droit, même avant la création de l’université égyptienne. Ils s’étaient formés à l’école française du droit de Mounira. Depuis le temps du khédive Ismail al-Tawfik, tous les illustres leaders du mouvement nationaliste égyptien se sont formés en France. Saad Zaghloul, Mostapha Kamel, Mohamed Farid et les autres, sont les produits de cette sorte de culture universelle reçue en France et cultivée sur le territoire égyptien mêlée aux traditions égyptiennes, donc une culture universelle nationalisée et adaptée aux besoins de la société égyptienne.
Mes quatre années à l’Université de droit du Caire ont été des années de formation très utiles pendant lesquelles j’ai été marqué par des Professeurs comme, pour ne dire que quelques exemples, le Professeur de droit musulman Monsieur Cheikh Abdel Wahab Khalaaf qui avait une pédagogie extraordinaire malgré le fait qu’il n’ait pas étudié les méthodes modernes. Il pouvait détecter les moments où nous étions moins attentifs, changer de sujet et nous parler d’autre choses pour maintenir notre concentration ; je me rappelle très bien de ses mots qui me viennent à l’esprit plus de soixante ans plus tard. Le Professeur Abdel Wahab Khalaaf soutenait qu’il existe des solutions que l’islam ne peut imposer, des choses lourdes qui pèsent sur le bon musulman. Il faut, lorsqu’on a le choix entre rigidité et souplesse, toujours rechercher la solution la plus adaptée aux besoins secondaires, « je n’aime pas le mot … parce qu’ils seront difficiles à accepter »[1]. Il faut se permettre, si Dieu a voulu que nous puissions faire le pèlerinage à la Mecque par avion, c’est préférable que de prendre un chameau et passer deux semaines de voyage. C’est une facilité que Dieu nous a permis et c’est à nous d’en profiter ; par exemple : « Dieu nous a créé pour ne pas nous faire subir des peines »[2] ce sont des principes et des idées, peut être simples, mais qui démontrent l’esprit de tolérance, l’esprit d’ouverture qui avait cours dans les facultés de droit à l’époque. Si on compare ça avec les fanatiques religieux qui prêchent ici ou dans d’autres pays, on voit que nous étions vraiment privilégiés par nos maîtres et professeurs.
Je me rappelle par exemple de la première fois où le professeur Amin Badr a demandé à quelques étudiants de faire des recherches à la bibliothèque sur certains projets. J’en avait profité pour me plonger dans la Littérature juridique, les arrêts et les décisions de tribunaux mixtes afin d’étayer mon argumentation. J’avais fini mes recherches et je m’étais étonné quelques semaines après, quand devant tout le monde – les 300 étudiants de l’amphithéâtre – le professeur a demandé « est ce que Monsieur untel (en prononçant mon nom) est présent ? », j’ai répondu « oui », il m’a dit « j’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre étude » il m’a félicité. C’était pour moi un couronnement et un encouragement incroyable, j’étais en quatrième année de droit. Voilà le type de rapport et de relation qu’on avait à la faculté de droit. J’aimais le droit avant même d’entrer à la fac de droit et avoir vécu quatre ans dans ce climat ouvert dans l’optique de découvrir le monde juridique m’a permis d’être à la tête de ma promotion en sortant de la faculté de droit.
Le résultat de cet amour pour le droit c’est qu’une semaine après les résultats de licence j’ai reçu une lettre du secrétaire général du conseil d’État égyptien qui demandait, comme j’étais parmi les quatre premiers de ma promotion, d’effectuer les démarches nécessaires pour être nommé au Conseil d’État comme auditeur adjoint. Petite anecdote, quand je me suis présenté devant le monsieur qui s’occupe du personnel, lui avec sa tête de bureaucrate typiquement égyptien, il m’a regardé , a découvert que je n’avais pas encore 21 ans (j’avais à peine 20 ans et quelques mois) et il m’a dit, « mais, monsieur, vous ne pouvez pas être nommé au Conseil d’État parce que vous êtes mineur, il faut attendre d’avoir l’âge de 21 ans ». J’étais sur le point de sortir, de quitter le CE quand j’ai aperçu le Secrétaire Général du CE qui m’a dit « il faut faire vite, les examens médicaux sont terminés, avez-vous les documents nécessaires ? Parce qu’il y a une assemblée générale pour prendre serment devant l’Assemblée nationale le 10 août ». J’ai répondu : « mais je ne serai pas nommé », et il m’a dit « pourquoi ? », « parce que je n’ai pas encore 21 ans », et il m’a dit « viens viens ». J’étais dans l’antichambre du président du CE que j’entendais, parce la porte n’était pas très bien fermée. Sanhoury Pasha lui-même, le président du CE à l’époque qui disait au monsieur du personnel, je ne cite pas son nom : « Oui il sera nommé même s’il a 7 ans, tu ne peux pas m’imposer ta propre voie de l’interprétation du droit, je suis le président, je prends la responsabilité ». Je suis retourné voir ce monsieur-là qui n’était pas content du tout mais j’étais nommé, et j’ai prêté serment devant une assemblée qui englobait une soixantaine de conseillers avec les tarbouches et les habits officiels. C’était quelque chose d’inoubliable pour un jeune qui, à 20 ans, devenait membre de cette illustre institution.
L’autre surprise c’est lorsque qu’on m’a nommé secrétaire technique pour la deuxième chambre consultative du CE spécialisée dans les contrats de l’État pour revoir et pour préparer les documentations nécessaires et donner un avis sur les problèmes contractuels (en 1952-1953) C’était en plein révolte. Je suis entré à la faculté de droit en 1948, et le jour de la révolution, le 23 juillet 1952 le résultat de licence était annoncé. Le 10 août je suis entré au CE et durant cette période-là, je travaillais, et heureusement j’étais très proche de Sanhoury Pasha qui m’a épaulé, parce que responsable du travail de la section consultative sur les contrats, deuxième section, j’avais une séance par semaine durant laquelle je lui exposais ce qui arrivait, les décisions prises, etc. À l’époque, il y avait une loi sur les marchés publics qui exigeait qu’un membre du Conseil d’État soit présent, j’étais envoyé pour contrôler la légalité de ce qui se passait et surtout avec les militaires qui étaient en vogue dans la société, je suis entré en conflit avec quelqu’un qui était le deuxième homme au Ministère de la Défense. Il voulait négocier avec un compétiteur qui n’était pas celui qui a fait l’offre la plus avantageuse pour le gouvernement. Je lui ai dit « ce n’est pas permis, vous devez commencer dans l’ordre, éliminez le premier pour commencer avec le deuxième », il n’était pas content, j’ai présenté mon opinion et j’ai quitté la réunion. Sanhoury Pasha a été saisi par ce monsieur-là et m’a convoqué deux heures plus tard pour me dire « Félicitions, j’ai donné appui à ton opinion. Il faut éduquer le peuple à respecter le droit ». Voilà des exemples de la manière dont on devient un bon citoyen, quelqu’un qui respecte le droit et la règle du droit. Ce sont peut-être des leçons qui m’ont influencé toute ma vie jusqu’à aujourd’hui. J’étais fier d’avoir été félicité par le grand Sanhoury pour avoir tenu tête à quelqu’un qui avait un bureau rouge ainsi que l’illustre et magnifique habit militaire. Je n’ai pas du tout été intimidé par lui et ses amis. Ils me considéraient comme un gosse qui venait perturber leur travail. Je lui ai dit « non, c’est la loi, il faut respecter la loi » Voilà comment j’ai vécu cette période.
Je peux vous dire que durant les deux ans où j’ai eu la chance de travailler avec le grand Sanhoury pour lui expliquer ce qui se passait dans notre section du CE, j’ai appris des choses qui m’ont servi toute ma vie. Voilà l’avantage que j’ai eu. Mais bien sûr les choses ont changé quand Sanhoury a été frappé par les fanatiques qui étaient contre la démocratie. Ils s’étaient organisés avec l’appui de quelques militaires pour attaquer le conseil d’Etat. Le pauvre a été blessé. J’ai essayé de lui rendre visite à l’hôpital sans succès. Sanhoury était si catégorique qu’il avait accusé le groupe des Officiers libres y compris Nasser, d’avoir organisé cette attaque contre lui, ce qui, à l’époque, a marqué la rupture entre le CE et les militaires. On a pris une décision fâcheuse – celle de se débarrasser de Sanhoury. Le conseil révolutionnaire a promulgué une décision. Tous ceux qui avaient un poste ministériel sous le roi Farouk ont été déchus de leurs droits civiques, et ainsi Sanhoury, le seul à avoir été ministre avant la Révolution, a été destitué de son poste au CE. On a déclaré le poste du CE vacant pour nommer quelqu’un. Moi j’étais parmi les rebelles, parmi les jeunes du CE, je m’attendais à en être chassé. Mais le nouveau président a dit « c’est un gosse qui a à peine 22 ans ou 23 ans, il ne faut pas lui imposer ça ». Il a demandé que j’aille à la section judiciaire comme commissaire du gouvernement pour la première chambre qu’il présidait, je l’ai pris comme une opportunité intéressante. J’y suis restée deux ans. À l’époque on a créé la Cour Supérieure administrative, j’étais aussi le commissaire du gouvernement le plus jeune dans l’Histoire du CE égyptien, peut-être dans le monde. Mais j’étais très fâché de voir que des décisions étaient attaquées non pas pour des raisons juridiques mais pour faire plaisir aux hommes politiques. Ainsi j’ai décidé de quitter le CE égyptien, on a essayé de me garder mais je suis parti. C’était en 1956.
Pour me faire plaisir, on m’a envoyé pour un stage auprès du CE français. Là-bas, c’était l’été, deux jours après la nationalisation du canal de Suez, tout le monde était agité. Un égyptien n’était pas le bienvenu à cette période mais j’ai quand même essayé de profiter de ce stage au CE. En allant au palais royal, le concierge m’a dit : « mais nous sommes en vacances ». J’ai dû y retourner début septembre. J’ai pris la décision de découvrir Paris à ce moment-là pour ne pas être avec les autres égyptiens dans des réunions inutiles, en discutant de ce qu’il faut faire ou ne pas faire et comment le pays va sortir des conséquences de la situation politique. J’ai découvert Paris à pied. Chaque jour je prenais un guide pour aller découvrir les beautés des p’tits endroits à paris. L’après-midi j’étais à l’Alliance française pour améliorer ma langue française et, pour moi, ces deux mois jusqu’à l’ouverture du CE, ont été une aubaine pour voir les secrets de la beauté et de la civilisation française telle qu’elle se manifeste au Louvre ou dans les autres endroits pittoresques qui existent à Paris. C’était ma première visite en France, c’était la découverte d’un monde nouveau. J’étais vraiment bénéficiaire de cette ville incroyable. J’adorais la Seine, le quartier latin, les jardins du Luxembourg, des endroits pittoresques. J’adorais aussi les collections de livres. J’ai découvert la collection « Que sais-je ? » et je peux vous dire honnêtement que chaque semaine je choisissais des livres, 2 ou 3, de cette collection pour les lire. C’était une ouverture d’esprit, c’était avoir conscience de ce qui se passe dans le monde. C’est une période que je ne peux pas oublier, c’était la formation d’un jeune avide de savoir. Comment le monde actuel vit en liberté. Dans une démocratie, où des valeurs d’égalité, de traitement humain, étaient la règle. C’était le cas en France et pas dans beaucoup d’autres pays.
Terminant ma mission au CE, j’ai essayé de m’inscrire à la faculté de droit et obtenir un prolongement de séjour. En mai 1957, j’ai obtenu un DES à Paris. Mes collègues égyptiens me croyaient fou, comment après quelques mois à Paris, je pouvais être en mesure d’obtenir un diplôme d’études supérieures. À l’époque il n’y avait qu’un seul endroit où faire du droit, l’université Panthéon, Assas n’existait pas. J’avais des professeurs formidables. J’ai pu, en même temps, avoir un diplôme de droit comparé à l’Institut Saint guillaume.
En rentrant en Égypte, à la fin de l’année 1957, la situation au CE avait empiré, l’intervention du politique dans le travail du CE est devenu vraiment intolérable. J’avais choisi comme sujet de thèse sous la tutelle du doyen Vedel « la transformation de la jurisprudence en Egypte ». Mes lectures sur l’Histoire du CE en France ont démontré un rapport entre démocratie et respect du droit. Dans des périodes de dictature comme c’était le cas en France sous l’Empire , Napoléon III ou le régime de Vichy, le rôle du CE, était réduit. Mais avec le retour de la démocratie accompagnait le retour d’un rôle plus important pour le CE. C’était le constat qu’on pouvait faire en observant la III et IVe République (à l’époque il n’y avait pas de Ve République, De Gaulle n’était pas encore arrivé au pouvoir). J’ai essayé de faire une sorte de synthèse sur le rapport entre l’épanouissement du contrôle du CE et la démocratie. On m’a interdit, en Egypte, de traiter de ce sujet. J’ai donc décidé de quitter le CE. Le président m’a dit que c’était un sujet inapproprié si je restais auditeur au CE. Je ne devais pas faire une pareille étude. J’ai donc choisi d’accepter le poste d’assistant à la fac de droit, dans la section de droit international privé. C’était le seul poste disponible. Pour vous présenter les choses, au CE nous étions privilégiés, le salaire mensuel était de 49 LE. Le poste de professeur assistant était rémunéré au maximum de 35 LE. Je sacrifiais donc 14 LE qui représentaient le prix du loyer de mon appartement.
Le président de l’université Shams – où j’ai accepté de devenir assistant – m’a demandé, parce qu’il était impressionné, les raisons de mon choix. Pour lui soit j’étais fou, soit je désirais profondément devenir professeur. Je lui ai expliqué les raisons de mon départ du CE. A l’université, la liberté est assurée et je pouvais profiter de mes capacités en droit pour m’exprimer. Il m’a encouragé en me demandant de retourner en France, avec une bourse d’étude qui m’accordait l’équivalent de 750 nouveaux francs mensuels, 75.000 francs. C’étaient amplement suffisant pour louer une chambre dans une famille. C’était une bourse du gouvernement égyptien, de la fac de droit d’Ain Shams, et en plus je mangeais au restaurant égyptien pour 75 centimes le repas. On vivait comme des rois et on côtoyait la jeunesse musicale de France. Je pouvais aller au théâtre, à l’opéra à des prix très avantageux. C’était une période de découverte. En suivant le conseil du président de l’Université d’Ain Shams qui m’a dit « Mon petit, ce sont des années de formation. Tu dois accumuler autant de connaissances que possible parce que pour le reste de ta vie, tu vas digérer les choses acquises durant ces années d’études dans un pays comme la France.»
Je suis resté trois ans en France pour préparer une thèse sur la notion de contrat international avec le doyen Yvon Loussouarn. À l’époque il était le doyen de la faculté de droit de Rennes. Quand je lui ai transmis mon manuscrit, qui comptait plus de 800 pages, il m’a dit, « ça c’est suffisant » !
Je voulais faire et peut-être que c’est un aspect que je dois confesser : j’étais influencé par ma lecture de Sanhoury qui dans ses jeunes années après son retour de Lyon et avant de devenir professeur au Caire, avait élaboré une théorie du contrat.
J’avais lu durant mes années au CE un ouvrage formidable d’un professeur français sur la notion de contrat administratif. Je me suis dit que je ferai un travail sur la notion de contrat international et je l’ai fait. J’ai étudié au CE égyptien les autres exemples de contrats, surtout dans le domaine pétrolier – parce qu’à l’époque il y a avait les grands arbitrages (cf : Aranco), où on se demandait comment des concessions données dans les années 1930, pouvaient survivre 50, 60 ans. Comment la stabilité et l’évolution pourraient être aménagées d’une façon à permettre que principe de pacta sunt servanda, le respect du contrat, puisse marcher de concert avec le rebus sic stantibus, les changements de circonstances, comme ça a été le cas dans les contrats administratifs en France. Pour vous donner un exemple, les contrats pour le développement dans les pays émergents pourraient être aménagés, surtout si ces contrats ont été obtenus durant la période coloniale pour s’adapter aux besoins des pays après l’indépendance. Avec tout ce qui était en vogue à l’époque comme la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et le droit des pays au développement. En tant qu’égyptien, j’étais sensible à ces sujets, j’ai donc opté pour une étude sur « l’équilibre du droit et de l’équité dans ce domaine ».
Voilà la première phase de ma vie en droit. Elle s’est terminée en France le 3 juillet 1962 avec l’obtention d’un diplôme d’État avec mention « très honorable ». Ma thèse était retenue pour le concours et a obtenu le prix de la meilleure thèse de l’année, c’est une chose dont j’étais très fier, surtout que parmi mes collègues beaucoup sont devenus d’illustres professeurs en France et j’étais privilégié, par rapport à eux. Je n’avais pas, ni de complexe d’infériorité ni de complexe de supériorité mais j’étais conscient d’une chose : avec un travail sérieux, on peut arriver à être un bon juriste au service de la paix internationale, de la prospérité et du développement. Ceci pour mon propre pays et pour les autres pays du monde. Voilà mes années de formation.
Je trouve que je dois beaucoup à la France parce que c’est là-bas que j’ai obtenu l’équipement intellectuel nécessaire pour être un bon citoyen. Non seulement un citoyen de mon pays mais aussi un citoyen ouvert aux autres cultures et civilisations. J’ai rencontré en France parmi mes collègues, parmi mes amis et les familles de mes amis, des gens qui ont changé ma vision du monde en tant que jeune égyptien. Dans mon enfance, il y avait des idées fausses, la supériorité religieuse de l’islam par exemple qui empêchait les gens d’apprécier les autres. J’ai trouvé des gens plus proches de Dieu que des pratiquants musulmans qui trichent, qui ne suivent pas les règles morales. La moralité et l’amour des autres, et l’amour de l’humanité sont des valeurs universelles qui ne sont pas particulières à une civilisation quelconque ou à une religion quelconque. C’est un esprit de fraternité que j’ai retrouvé à Paris, même sur le plan musical avec la 9ème symphonie de Beethoven. On sait très bien que nous sommes des frères du monde, que nous devons devenir plus solidaires pour avoir une société globale qui embrasse tout le monde et qui permet la vie en paix , permanente. Dans le monde idéal que nous devons créer, par la supériorité du droit, et le respect de la légalité et de la justice.
II – L’expérience d’un professeur égyptien de droit
[Le 3 juillet 1962, Ahmed El Koshery soutenait sa thèse avec le doyen Loussouarn (auteur du précis Dalloz en droit international privé)]. Le doyen Loussouarn était conseiller d’Etat, il était remarquable. Il appartenait à l’Ecole de Dijon.
Le deuxième volet du récit de Mr. Koshery s’intitule « Expérience d’un professeur de droit égyptien » ou en d’autres termes : « Ahmed El Koshery, l’universitaire en droit »
Le retour en Égypte s’est fait en bateau (parce que j’avais plusieurs caisses de bouquins). J’avais beaucoup de rêves à réaliser. Je n’avais ni voiture, ni appareils ménagers. Tout était de droit, tout ce que j’ai pu accumuler comme ouvrages. J’espérais qu’en Egypte j’aurais l’occasion de continuer en tant que jeune enseignant de droit à l’Université Al Shams. C’était fin aout, début septembre 1962, pour être présent à la rentrée universitaire.
La première difficulté que j’ai rencontré, c’est avec le doyen de l’université d’Ain Shams, qui était mon maître. Il m’a ouvertement dit qu’un jeune comme moi devait s’occuper des « sections », de petits groupes, soit l’équivalent des travaux dirigés (les travaux dirigés en France ont un programme bien établi). J’ai essayé de faire un bon travail mais j’ai aperçu une chose qui m’a, à l’époque, étonné. Contrairement au climat général de la faculté de droit quand j’étais étudiant au Caire, ceux qui étaient admis en 1960-1970 à la fac de droit n’ont pas choisi le droit par vocation ou choix libre. Ils étaient dirigés par un bureau central qui fonctionnait selon des critères …. Les meilleurs élèves étaient dirigés vers médecine, ingénierie, le domaine scientifique et les étudiants médiocres venaient à la faculté de droit, de lettres ou de commerce.
Le niveau des étudiants m’a choqué. Ils n’avaient pas vraiment la formation nécessaire, le désir ou une croyance dans le rôle du droit dans la société. Ils étaient marginalisés par le pouvoir politique totalitaire qui existait à l’époque et ils ne cherchaient qu’à avoir un titre universitaire pour devenir fonctionnaire d’Etat, même pas avocat libre, ou membre des corps de justice. On acceptait des milliers d’étudiants qui n’étaient pas destinés à avoir un rôle dans le domaine du droit. Ça m’a choqué et ils n’étaient pas prêts à faire d’efforts. Ils venaient dans ces classes simplement pour prendre note. Quand je demandais qu’ils réfléchissent en leur donnant des cas d’étude, des affaires jugées ailleurs, surtout en France, ils disaient « non monsieur le professeur, qu’est-ce que vous croyez ? C’est vous qui devez nous dire ». Ils refusaient d’utiliser leur tête pour avoir une réflexion personnelle. C’était une continuation de l’éducation des écoles coraniques où on récite le Coran et où il n’est pas permis de réfléchir ou de comprendre, d’interpréter ou d’arriver à des conclusions en analysant les textes de Coran. Le Coran pour eux c’est ce que le professeur disait, et ils devaient apprendre ça par cœur pour le mettre sur papier à l’examen de fin d’année.
Il y avait à l’époque, quand j’étais étudiant à l’Université du Caire, un examen oral. Mais l’oral a été supprimé parce qu’avec ces milliers d’étudiants on ne pouvait pas l’organiser. Il y avait donc un examen écrit sur un sujet qui était un titre dans un ouvrage. S’il y a trois pages, il faut mettre les trois pages. La meilleure note allait à celui qui répétait ce que le professeur avait dit sur ce sujet-là. C’était pour moi une chose terrible parce que comment pouvait-on changer leur mentalité ? Je leur demandais de réfléchir. Par exemple à l’époque il y avait une affaire sur la nationalité devant la Cour Internationale de Justice, concernant quelqu’un dont le nom était Nottenbohm, un allemand, qui, durant la guerre était en Suisse. A Liechtenstein, il avait acquis la nationalité effective. J’essayais de faire vivre leur intérêt sur des cas pareils mais ils disaient « Mais quelle est la solution ? » et je répondais « Réfléchissez ». Personne n’en était capable, même les meilleurs parmi les étudiants ne croyaient pas en leur capacité à réfléchir et à donner des réponses à de telles questions. Ça a été un choc terrible pour moi.
La deuxième chose que j’ai observé, c’est qu’il n’y avait pas de fonds pour continuer à recevoir des périodiques, comme le Clunay ou la Revue Critique de droit international privé… Ils n’étaient pas disponibles parce qu’il n’y avait pas de fonds, et à chaque université on envoyait des bons UNESCO. Or c’était les facultés pratiques qui avaient la priorité. Ce qui m’a vraiment effrayé c’est d’être coupé du monde extérieur. Ça m’a fait beaucoup de mal. C’est pour ça que deux ans après, j’ai eu l’occasion d’être détaché pour enseigner à l’université arabe de Beyrouth et je l’ai saisie. Là-bas c’était le Paradis ! Le président de l’université était mon ancien professeur de droit pénal, Ali Rached, c’était un génie. Il m’a demandé d’aller enseigner là-bas. Je n’ai pas enseigné le droit international privé parce que les étudiants n’étaient pas en 4ème année et il n’y avait pas de 4ème année à l’époque. J’ai enseigné le droit des obligations et des contrats spéciaux y compris les contrats de vente et de travail. L’intérêt principal c’est qu’il y avait à peine 40 étudiants. J’ai trouvé là-bas un environnement où la contribution et le rapport entre professeur et étudiants était possible. Ce n’était pas les amphithéâtres pleins de centaines et de milliers d’étudiants comme à Ain Shams.
[Sur la situation des universités égyptiennes et les réformes de Nasser]
J’essayerai d’être neutre. Nasser avait une politique dont les objectifs étaient très nobles, il croyait continuer la ligne de Taha Hussein qui avait dit que l’éducation pour l’homme et la femme c’est comme l’eau et l’air : c’est nécessaire, cela doit être ouvert à tout le monde et gratuitement. C’est très bon en tant que principe. Mais la conséquence c’était d’ouvrir les universités à des milliers de gens qui sortaient d’une éducation secondaire pas bien adaptée aux besoins du monde actuel. C’était une continuation de la tradition des koutabs où la méthode coranique prévalait, c’est-à-dire la récitation de ce que les bouquins écrivent. L’université était envahie par cet esprit-là, il n’y avait pas d’esprit critique de recherche, c’est ça le problème. La qualité a été sacrifiée pour la quantité. Vous aviez une quantité énorme de gens mais ils ne valaient rien. Le meilleur parmi eux n’aurait pas été le dernier de notre promotion 10 ans ou 15 ans auparavant. Le meilleur était celui qui apprenait par cœur le livre.
A Beyrouth j’ai trouvé un autre esprit dû au fait que le nombre était limité et ceux qui venaient voulaient faire du droit, c’était leur choix. Ils étaient libres de venir pour apprendre. Ils croyaient que dans la vie, ils auraient un rôle à jouer. Mais j’ai une réserve, j’ai découvert, par exemple, parmi les étudiants de deuxième et troisième année à qui j’enseignais à Beyrouth, durant cette période, des gens très intelligents mais dont les contributions dans les discussions n’étaient pas formidables. Je leur ai dit : « Mais monsieur, madame, vous êtes très intelligents, pourquoi ne pas faire d’effort ? » et ils me disaient « pourquoi faire un effort ? On sait où on sera casé après la licence à cause de la distribution professionnelle». Je me rappelle de quelqu’un qui me disait « je suis le seul druze dans la promotion, je suis sûr que j’aurai un poste au Ministère des Finances car il y a un poste réservé aux druzes. Je suis le seul dans la promotion donc pourquoi faire un effort ? ». Cette distribution professionnelle dans le système libanais était une chose très choquante. Ce n’était pas un système égalitaire, il y avait des postes réservés pour les maronites, les sunnites, les chiites, les druzes, etc et même pour les romains orthodoxes ou les arméniens. Il y avait des quotas et donc ça limitait nécessairement la compétition entre les gens. Ils savaient auparavant, donc quel intérêt pour eux d’apprendre et de faire un effort supplémentaire ? Il y avait des limites.
Mais Beyrouth était ouverte à l’époque. Il y avait des bouquins qui n’existaient pas en Egypte disponibles là-bas. C’était pour moi le paradis terrestre, un retour à Paris. C’est un petit Paris que j’ai trouvé là-bas. L’année que j’ai passé à enseigner le droit des obligations et le droit des contrats à Beyrouth a été une année bénéfique. Ça m’a permis durant l’été d’aller à l’Académie de droit international. C’était pour moi une expérience éblouissante dans le sens où il y avait une vingtaine de gens choisis dans le monde tout entier. Ils étaient réunis autour d’un thème avec un professeur renommé qui dirigeait ce Centre. Durant huit semaines, on préparait un rapport et on le discutait ensemble et durant ces huit semaines j’ai appris beaucoup de choses. J’avais le privilège d’être dans la section française parce qu’il y avait une section française et anglaise. La section anglaise était dirigée par mon ami Boutros Boutros-Ghali mais j’étais dans la section française avec René Jean Dupuy ; un éminent professeur avec lequel j’ai eu des attaches très profondes durant le reste de sa vie. En découvrant un savant ouvert qui donne le temps aux étudiants (nous étions une vingtaine comme je l’ai dit) j’ai profité énormément de sa science, la façon avec laquelle il dirigeait ses séances. J’ai fait un rapport sur les juridictions administratives internationales et dans quelle mesure le juge créait des règles applicables pour les fonctionnaires internationaux et le professeur Dupuy était content de mon travail.
Je dois signaler une chose. Parmi mes collègues dans ce groupe limité de chercheurs, il y avait quelqu’un qui était avec moi à Rennes, nous avions passé le diplôme ensemble, il a soutenu sa thèse la même année que moi, j’étais reçu premier, lui deuxième. Pour la thèse j’ai reçu le prix de la meilleure thèse, lui non. Selon les critères objectifs, j’étais à pied d’égalité durant nos études en France mais j’ai découvert que, moi, coupé du monde extérieur en Egypte durant plus de deux ans, et lui en France, il a acquis des choses, il me parlait de choses comme si j’étais un villageois qui venait pour la première fois découvrir la ville. J’ai senti qu’être resté en Egypte pour enseigner à des milliers d’étudiants sans avoir la possibilité d’acquérir des connaissances sur l’évolution qui avait lieu dans le monde extérieur était une chose inacceptable. Et à partir de ce moment, durant mon séjour, j’ai essayé de me rattraper et d’avoir des accès pour suivre les développements qui avaient lieu en France et dans le monde, ce qui m’a conforté :
-premièrement, je devais travailler ma connaissance juridique et l’enseignement que je devais donner en Egypte devait être en mesure de me permettre une ouverture sur le monde extérieur et apporter des connaissances nouvelles. Il s’agissait de ne pas redire ce que mes professeurs m’avaient dit et de continuer selon la tradition islamique d’une génération à l’autre, comme « les maitres ont dit ça, nous suivons», cette mentalité-là, où la fermeture de la voie d’ijtihad (unicité) à l’innovation était la chose la plus pénible au monde. Je crois que c’est la raison de nos problèmes actuels dans le monde arabe et islamique. On a cessé d’utiliser nos propres cerveaux pour simplement répéter ce que nos ancêtres ont dit il y a quelques siècles. Ça m’agace de penser comme ça.
De retour en Égypte, j’avais un petit cours de droit international privé à la Faculté de droit et à l’École de police. Eux ils recevaient une licence de droit. C’était en 1965-1966. J’ai essayé de leur donner des idées nouvelles mais pour être très franc avec vous, mon chef de département n’était pas content et pour cela, il voulait me donner une leçon terrible. Le cours que j’enseignais à la fac de droit et à l’école de police, a été sanctionné, aucune question à l’examen à la fin de l’année ne devait porter sur ce cours comme pour dire aux étudiants « cet imbécile-là, tout ce qu’il vous a dit, ne compte pas, c’est simplement la partie que j’enseigne qui doit être prise en compte ». Ça m’a révolté et j’ai saisi l’occasion pour avoir une deuxième occasion à l’Académie de droit internationale à La Haye et d’essayer d’avoir un poste de chercheur en France l’année suivante.
A La Haye, le Centre en 1966 était dirigé par un éminent professeur que je n’oublierai jamais, Monsieur Francescakis, une lumière en droit international privé. C’était lui qui dirigeait la Revue critique de Droit International Privé, un proche collaborateur du doyen Battifol et un monsieur dont le savoir égal ses valeurs humaines, très bonnes. Au Centre à La Haye, durant les 8 semaines, j’ai travaillé avec lui. C’était une source de joie incroyable et cela s’est soldé sur un rapport que j’ai fait sur les nationalisations des pays du tiers monde devant le juge occidental. Un autre collègue italien, a fait un rapport sur les nationalisations sur les sociétés (…) en Allemagne de l’Ouest et ses implications ailleurs. Nous étions une quinzaine dans la section française dirigée par Francescakis. A la fin de la session, il nous a convoqué tous les deux, Tonio et moi, pour nous dire qu’il est content de notre rapport. Il nous a dit que si nous faisions un effort, pour le transformer en article, il était prêt à publier ça dans la Revue critique de droit international privé. Pour moi, c’était quelque chose dont je ne pouvais rêver car je sais qu’il y a des professeurs égyptiens et autres qui ont essayé auparavant, de grands noms, de publier dans la revue critique mais malheureusement ils étaient refusés. Pour un jeune enseignant comme moi, avoir l’occasion de publier dans la revue critique sous le patronage de Francescakis, c’était quelque chose d’incroyable.
Je peux, pour la postérité, vous dire la leçon que j’ai obtenue sur ce travail. Francescakis m’avait fait une liste d’observations et il m’a demandé d’aller préparer un texte. J’ai préparé le texte et 15 jours après il m’a fait remarquer certaines lacunes, certaines choses que je devais accomplir et à la dernière tentative, je lui ai soumis 80 pages. Il m’a dit « Ahmed maintenant, c’est très bien mais simplement, il faut réduire ça à 40 pages sans omettre aucune idée essentielle dans cet article ». Pour moi c’était une demande très difficile parce que comment faire ça ? Je me suis concentré sur ses propres écrits, j’ai trouvé la clé. C’est un éminent professeur qui ne répétait pas les idées des autres dans le texte, il y faisait référence « sur cette notion-là, regardez tel ouvrage ou tel article »donc tout ce qu’il y a dans le texte, c’était ses propres idées. Mais les idées approfondies par les autres se trouvent dans les notes de bas de page. J’ai essayé de faire ça, parce que c’était le contraire de la méthode suivie dans les bouquins égyptiens, on commence par ce que les autres ont dit. Par exemple, si on parlait de droit international privé, on commençait avec ce que Bartin, Boyen, Batiffol, Loussouarn ou Pigeonnière avaient dit. Puis c’était un récit des écrits des autres et l’apport personnel n’existait pas. C’est pour cela, pour moi, que Francescakis m’a ouvert les yeux sur l’essence d’une contribution véritable à la science. On doit faire. Il ne faut pas répéter bêtement ce que les autres ont déjà dit et approfondi. Ce n’est pas un exposé de la situation actuelle mais un pas pour avoir des idées nouvelles qu’on doit défendre. A ma quatrième et dernière tentative, je suis venue avec un texte de 40 pages en essayant de mettre les références en notes de bas de page et il a dit « Maintenant on peut publier ». Et le jour où est paru le numéro de la revue critique avec mon article sur les nationalisations devant le juge occidental, c’était un jour aussi important que le jour de la soutenance de ma thèse. Pour moi, c’était vraiment là que je suis entré dans le club des gens reconnus comme capable d’écrire dans une publication internationale.
Ce qui m’a encouragé à rester dans ce domaine-là est le fait que l’Académie de droit international où j’ai eu ces deux occasions de recevoir la formation en 1964 et 1966, a continué deux ans après. En 1968, il y avait le premier colloque organisé par l’Académie sur les accords du commerce international. A ce moment-là, nous étions cinq jeunes rapporteurs, et devions faire le rapport devant une vingtaine de grands noms. Les noms les plus célèbres dans le domaine du droit international privé et public, spécialisés dans le commerce, les investissements et les financements, etc. On est resté 10 semaines à travailler ensemble. Un fait que je n’oublierai pas, j’ai découvert durant cette période un rapport d’affinité intellectuel énorme avec Philippe Kahn, qui venait de Dijon, dont la thèse sur la vente internationale avait été publiée quelques mois auparavant, avant la soutenance de ma thèse. Je connaissais les idées de Philippe Kahn mais là-bas, à La Haye, on est devenu de très bons amis et on a eu des discussions intellectuelles qui ont abouti à une amitié, une fraternité qui reste jusqu’à aujourd’hui. Philippe Kahn n’est pas seulement un ami, c’est un frère. Je partage avec lui la vision du droit, la façon dont on doit enrichir la théorie par un recours à la vie pratique. Sans avoir eu l’occasion d’étudier à Dijon, sous l’influence de professeur Motulsky et la continuation de professeur Goldman, je suis pratiquement devenu un membre du club de Dijon. Parmi des gens qui s’occupaient de la lex mercatoria et du développement des pratiques dans le droit économique international. Ce dernier doit faire en sorte que la vie continue et s’adapte aux besoins à quelques principes généraux. Cela peut engendrer des règles qui n’ont pas de source formelle, sous forme de traité ou législation nationale mais être accepté comme des données de base dans la vie pratique. Ça m’a aidé énormément dans l’orientation de ma pensée.
Ça s’est manifesté essentiellement quelques années plus tard. Je dois reconnaître que mon premier maitre à La Haye, professeur Dupuy, qui est devenu après Secrétaire général de l’Académie de droit international, m’a permis d’être choisi pour donner un cours de cinq heures à l’Académie en 1975. Et sous l’influence de mes convictions concernant l’importance de sources non formelles du droit, j’ai choisi comme sujet, accepté par le coratorium de l’Académie, « le régime juridique créé par les accords de participation dans le domaine pétrolier ». Le titre est un peu long. (la lex petrolia) Ce sont les accords de participation qui ont changé le visage des rapports entre les grandes sociétés actives dans le domaine pétrolier et les États hôtes. La conception traditionnelle a été remplacée par des participations où les sociétés nationales créées par l’État sont devenues des partenaires de sociétés internationales ou transnationales dans le domaine pétrolier et plus tard dans le domaine du gaz. Ce jour-là, en 1975, mon intervention en français à l’Académie, a été très appréciée.
Entre parenthèse, et c’est une chose que j’ai apprise par l‘intermédiaire d’une dame très gentille qui s’occupait du Secrétariat de l’Académie et qui avait pour mission de minuter l’applaudissement après chaque cours qu’elle reportait au secrétariat général et au coratorium pour apprécier l’accueil de la leçon par les auditeurs dans la salle. Elle m’a fait la confidence que j’étais parmi les plus applaudis, un signe de succès que j’ai accepté avec plaisir. Le plaisir réel c’était après la publication de ce cours, au recueil du volume numéro 147 des cours de l’Académie, cette collection qu’on considère comme une source de connaissance juridique inégalable. Ne me traitez pas d’orgueilleux, mais ce que j’entendais par les autres c’est que « ceux qui arrivent à donner des cours et à être publiés dans le recueil de cours de la Haye sont immortels ». Dans quelle mesure c’est vrai, ce n’est pas à moi de dire. J’étais content d’être considéré par les uns au moins, comme un des immortels grâce à ces cours à la Haye. C’était une étape importante dans ma vie intellectuelle, qui m’a fait un plaisir énorme compte tenu des difficultés que j’ai rencontré dans mon enseignement au Caire. La matière de droit international privé est enseigné aux quatrièmes années. Dans les années 70 où j’enseignais, il y avait des amphithéâtres pleins de gens, au moins 2000 étudiants à qui je devais enseigner le droit international privé.
Le Conseil d’État n’était pas l’endroit idéal pour avoir une carrière, je dois signaler l’importance de cela. Je parlais des rapports entre la qualification, le rattachement et le renvoi. J’essayais d’expliquer aux étudiants de 4ème année de droit international privé l’affaire Patino qui était une affaire citée dans les ouvrages français très connue et très intéressante. Je parlais devant des étudiants presque endormis, même pas un signe de compréhension ou d’appréciation de mes cours. Un jour, je me suis soudainement arrêté pour leur dire : « Je parle arabe ou chinois ? Vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas ? » Une voix vînt de loin, je ne pouvais pas l’identifier car l’amphithéâtre était très grand, mais cette voix avait l’accent des gens du Sud de l’Égypte, les Saidiens. Elle me dit : «Mais professeur, vous perdez votre temps, nous n’aurons jamais dans l’avenir l’occasion de voir une affaire de droit international privé, et pour vous dire la vérité, même pas de droit. Nous sommes condamnés à venir dans cette faculté pour avoir une licence qui va nous permettre de devenir commis de l’État. Nous serons peut-être nommés dans une coopérative de Haute-Egypte ou ailleurs pour avoir un salaire de minimum 12 ou 15 livres par mois. Le droit pour nous c’est rien. Pourquoi vous perdez votre temps ? Donnez-nous ce certificat et c’est réglé». Pour moi ce que ce monsieur dit alors m’avait fait l’effet d’une douche froide et m’avait ouvert les yeux sur le fait que j’étais vraiment un acteur de mauvais goût dans une comédie qui n’avait pas de sens. Oui pourquoi ces milliers de jeunes gens venaient-ils à la faculté de droit ? Pour étudier un droit auquel ils ne croient pas. Ils ne croyaient pas à la mission du droit dans la société. Ils n’auront jamais la possibilité de devenir ni avocat, ni juge, ni auxiliaire de justice.
Pourquoi cette perte de temps, et des efforts et des vies humaines dans une entreprise qui n’a ni queue ni tête. C’est pour cela qu’au sortir de cette leçon-là, je n’ai pas pu dormir la nuit. Le lendemain je suis allé voir le doyen pour lui dire « à partir de l’année prochaine, je n’enseigne pas en licence, je donnerai un cour aux doctorats. Et je dois introduire un nouveau cours sur un sujet qui n’existait pas dans les facultés égyptiennes, c’est le droit économique international ». C’était en 1970-1971. Il m’a dit qu’il était content parce que ça donnait l’occasion aux autres de vendre leurs polycopiés, d’être en mesure de vendre des milliers d’exemplaires à de pauvres étudiants. Mais moi, auprès des doctorats. Je n’avais pas l’intention de faire une fortune mais simplement d’essayer de mettre dans la tête de quelques-uns – qui voulaient poursuivre leurs études juridiques – des idées utiles sur l’évolution juridique dans le monde. Mais ma déception était due au fait que je leur disais « voilà je vous donne une introduction sur le droit économique international, l’évolution, les sources et tout ça et je vous donne une liste de lecture. Pour ceux qui connaissent l’anglais, il y a dix articles ou chapitres d’ouvrage que vous devez étudier et je vais vous aider à les comprendre ; et ceux qui connaissent le français, voilà dix autres articles. Et on va faire ça durant l’année. » Mais ça n’a pas plu à quelques-uns qui sont venus. Parce qu’on fait des études supérieures pour avoir cinq livres de plus dans le salaire. Si quelqu’un est diplômé en droit privé ou droit public, ou en droit international, il reçoit une augmentation de salaire ; Donc il y avait des gens qui venaient non par intérêt dans la continuation des études juridiques mais pour avoir un avancement dans leur carrière où ils travaillaient comme fonctionnaire d’État ou du secteur public.
Ils se sont plains au doyen. Ce dernier m’a convoqué pour me dire « Professeur, vous agissez contre la Constitution du pays » J’ai dit « Comment contre la Constitution ? », il m’a dit : « Oui, l’enseignement est en arabe, comment exigez-vous des gens des connaissances dans d’autres langues ? », Je lui ai dit « Mais en droit économique international, il n’y a pas un seul ouvrage ou article en langue arabe » Il m’a dit « Oui , écrivez quelque chose, traduisez et publiez », et j’ai répondu « Mais ce n’est pas honnête, ils doivent faire des recherches, ce sont des gens destinés à être des chercheurs pour faire des doctorats, ils doivent faire un effort en anglais ou en français ». Il m’a dit « non non non il faut trouver une solution ». Mais c’était la fin et ainsi j’ai renoncé, j’ai donné, j’ai essayé de résister, de trouver un petit groupe où je pouvais faire un effort. Et heureusement, des années après, j’ai rencontré des jeunes qui m’ont dit « Mr. Koshery, nous étions vos étudiants et vous avez dit l’importance d’étudier l’anglais ou le français, moi je suis allé à telle université, j’ai fait une thèse et c’est grâce à vous ». Je leur ai dit : « Au début c’est difficile, comme un train qui part de la gare, tchktchktcktck il marche difficilement, il avance à une petite vitesse. Si vous lisez dix pages, vingt pages, ça va augmenter vos capacités, en ouvrant un dictionnaire, en allant dans une université étrangère, faire des stages, faire des études, vous y arriverez. »Il y a des gens qui ont suivi cette route, ce qui m’a donné le soulagement que, au moins, mes années à Ain Shams n’étaient pas complètement perdu parce qu’il y avait de jeunes professeurs, de jeunes chercheurs qui ont bénéficié des petites graines que j’ai essayé de semer dans leur tête durant cette période-là.
Mais je regrette de vous dire que ma vie en tant que professeur était presque terminée parce qu’après ça, je m’occupais simplement de diriger certaines thèses de doctorat, de donner des cours ou conférences générales en Égypte et dans d’autres pays arabes ou même hors du Monde Arabe. Mes rapports avec les universités en France ont continué. J’avais été appelé pour donner des cours, participer à des colloques, et la plus grande satisfaction dans ma vie vient du fait que l’université de Dijon, en Bourgogne il y a deux ans ou trois ans, m’a accordé un doctorat honoraire pour l’ensemble de ce que j’ai fait dans le domaine du droit. C’était pour moi le couronnement d’une amitié avec toute une génération de jeunes juristes en France, qui a commencé avec Philippe Kahn, qui a continué avec Philippe Fouchard, avec Charles Leben, avec Geneviève Burdeau, avec Eric Loquin, avec beaucoup de figures de sciences juridique française, et surtout de l’école de Dijon, à laquelle (j’aimerais souligner que) j’appartiens comme un membre convaincu de l’importance de cumuler les études théoriques avec les aspects pratiques pour arriver à des solutions originales qui correspondent aux besoins de la vie pratique, économique, sociale et humanitaire dans le monde où nous vivons. Voilà en quelques mots la deuxième phase de ma vie en tant qu’enseignant de droit et chercheur, surtout chercheur. Je reste, jusqu’à ce moment-là, à plus de 80 ans, un lecteur. J’ai un plaisir énorme à découvrir une publication, un article, un commentaire de jurisprudence, comme un étudiant de première année de droit, jusqu’à maintenant. Et je crois c’est la raison d’être de ma vie intellectuelle. Etre étudiant à la recherche de la vérité.
III – La confrontation avec la vie pratique (1976/1977 – maintenant)
J’ai démissionné de l’université d’Ain Shams en 1976-1977. J’y étais contraint pour sauvegarder mes principes d’équité. Je crois que j’avais évoqué mes raisons : ma surprise en découvrant que j’enseignais une matière qui n’intéressait pas les étudiants qui venaient à la fac de droit sans être convaincus que le droit avait un rôle dans ce pays. Le jour de vérité ce fut quand cet étudiant m’a dit qu’ils n’auraient jamais l’occasion d’appliquer du droit ou d’être impliqué dans une affaire de droit international privé. La vie, pour la grande majorité des étudiants de droit, c’est de devenir des commis de l’État, qui n’appliquent ni le droit ni ne contribuent à la justice du pays. J’ai découvert qu’après la licence, une très infime minorité était capable de faire l’effort nécessaire d’étudier des langues étrangères et de consulter des ouvrages, des listes, des lectures que j’avais préparé pour eux en leur procurant des articles ou des passages d’auteurs bien connus en France et d’ailleurs afin qu’ils puissent bénéficier de la Littérature mondiale. L’atmosphère à la faculté de droit à l’époque m’avait déçu et c’était une perte de temps et d’intérêt pour devenir quelqu’un similaire à ceux qui enseignent dans les écoles corniques, le Coran. Le droit n’est pas le Coran. Le droit doit être enseigné comme une science pour des personnes qui s’intéressent à l’étude du droit.
Donc en essayant de trouver un endroit où je pouvais être utile, j’ai reçu l’offre de devenir le conseiller juridique du Fonds arabe pour le développement économique et social, c’est une institution : la banque régionale pour les pays arabes pour le développement économique et social. Le siège social était au Koweït. C’est une création de la Ligue arabe, à l’instar de la banque africaine de développement, la banque asiatique, la banque interaméricaine et bien sûr la banque mondiale qui était la source principale d’inspiration. J’y ai passé deux ans comme conseiller juridique fondateur du Fonds arabe au Koweït. C’était intéressant, je travaillais énormément, jusqu’après minuit tous les jours, pour préparer les institutions, les statuts, les closes modèles pour les emprunts et les accords conclus avec les Fonds pour financer certains projets. Ça m’a permis de voyager dans les pays de la Ligue Arabe. J’ai acquis une connaissance pratique dans ce domaine-là. En même temps j’étais invité pour quelques colloques et réunions internationales pour faire une contribution théorique. Ça m’a donné l’occasion d’être en contact avec le monde extérieur tout en ayant la possibilité de me lancer dans la vie pratique des relations économiques internationales. Je ne voyais pas vraiment une carrière dans ces institutions parce que comme conseiller juridique j’étais impliqué dans beaucoup de réunions administratives. Deux choses m’ont choqué et m’ont démontré que je n’étais pas prêt à devenir un fonctionnaire international.
– Premièrement, le recrutement des gens par mon poste ex officio. J’étais membre du comité de recrutement et j’ai vu qu’il n’y avait pas de critères objectifs. Le favoritisme comme il était exercé en Égypte était la règle. C’est un phénomène commun aux autres pays. Si on a une liste, le meilleur n’était pas nécessairement celui qui était choisi mais peut être quelqu’un à la dernière place ou même hors de la liste. Le parent d’un président ou d’un ministre avait la possibilité d’être nommé. Ça m’a choqué
– Deuxièmement c’était le choix des projets à financer. Il y avait des études très intéressantes, faites par des gens de la banque mondiale ou d’autres institutions internationales. Ils faisaient des listes de projets prioritaires. Par exemple dans le domaine de l’agriculture, on voyait que le Soudan pouvait devenir un terrain pour le développement et nourrir tout le monde arabe et même exporter. On pouvait avoir toutes les activités agricoles dans ce projet. Mais on a créé une organisation très faible, sans ressources. On préférait un petit projet dans le village natal de tel président de ce pays ou de l’autre, donc le choix des projets était motivé par des raisons politiques. C’est pour cela que je n’étais pas content. Si mon travail était simplement juridique, peut être que j’aurais été plus longtemps au Fonds arabe. Mon contrat était de deux ans et à la fin de la deuxième année, j’ai décidé de partir pour me lancer dans les consultations.
A l’époque j’avais eu la chance d’être associé avec la docteur Samia Rached qui était professeur de droit international privé à la Faculté du Caire. Elle était vraiment très intelligente. Elle pouvait diriger. Moi je n’aimais pas du tout être administrateur ou organisateur mais le travail intellectuel. C’était le point fort. C’est elle qui m’a aidé à avoir un cabinet de consultation international. Il a été créé quand les premiers cas des grands investissements sont apparus. L’année où on a commencé, j’étais sollicité par le premier ministre égyptien pour défendre l’Egypte dans l’affaire de « l’oasis des pyramides » ou « plateau des pyramides », c’était en 1978.
– L’affaire des pyramides
Mon collègue, le professeur Mohameh Hafez Ghanem, était vice premier Ministre. Alors qu’il était en poste, il mourut. Il était très jeune et le premier ministre d’Egypte, Fouad Mohieddin m’a envoyé une lettre pour me nommer directeur de l’équipe pour défendre l’Egypte dans cette affaire-là. C’était pour moi une grande responsabilité mais aussi une occasion d’appliquer des choses que je connaissais sur l’expropriation, la nationalisation et ses effets dans un contexte très important. J’ai défendu l’Egypte devant un tribunal arbitral constitué selon la forme de la chambre de commerce international. Sans aborder les problèmes, surtout les critiques de la part de mes collègues égyptiens qui n’étaient pas très coopérants. Ma ligne d’argumentation dans cette affaire-là a été appréciée plus tard, dans le sens où j’avais évoqué le fait que dans l’accord, la clause d’arbitrage n’était pas signée. L’Egypte en tant que gouvernement n’était donc pas impliquée mais c’est la société d’Etat Egoth qui avait signé avec le partenaire étranger. J’insistais sur le fait que le gouvernement égyptien n’était pas partie à l’accord d’arbitrage donc il n’y a pas de juridiction, pas de compétence du tribunal arbitrale à son égard. Ça n’a pas marché durant la procédure devant la CCI car il y avait une influence anglo-américaine énorme. Elle faisait en sorte que les témoignages des dirigeants de la société « SPP Middle East » impliquent l’Egypte. Car on n’aurait pas fait l’investissement ou conclu le contrat si l’Égypte n’était pas impliquée. Le ministre du tourisme après la signature d’un accord bilatéral avec la société Egoth avait signé sur la dernière page « agreed, approved and ratified, Minister of Tourism, Ibrahim Naguib ». En interprétant ce fait, l’Egypte est devenue partie du contrat par la signature du ministre.
Mon argument n’a pas marché devant la CCI mais ça m’a permis, en collaboration avec mon ancien maître qui avait soutenu ma thèse, le professeur Bredin, de faire un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris. Je me suis basé sur le fait que le système égyptien était calqué sur le modèle français. Le ministre, dans mon interprétation n’avait pas l’intention de présenter le gouvernement égyptien comme parti mais, en tant que ministre de tutelle, de représenter l’État et ses intérêts à l’assemblée générale de cette société. C’est comme ça que j’ai conçu l’affaire et son interprétation. Heureusement pour moi, ce point du vue a prévalu devant la Cour d’appel de Paris au premier ressort, il a également été reconnu à la Cour de Cassation plus tard. C’est une affaire qui a pris beaucoup de mon temps, ce qui m’était très cher. La première affaire où j’ai contribué pour mon pays, l’Egypte, sur un plan pratique. En même temps, une autre affaire est arrivée. J’ai été appelé par le ministre koweitien du pétrole pour plaider pour le Koweït dans l’affaire « Aminoil contre l’Etat du Koweït ».
– L’affaire « Aminoil contre l’Etat du Koweït »
Aminoil était une société américaine qui avait une concession au Koweït. Le gouvernement koweïtien avait l’intention, comme il a fait avec les autres sociétés, de participer et de prendre une part active dans la vie de cette concession. La société résistait en accumulant des bénéfices mis hors de l’Etat koweïtien. Le Koweït a été amené à nationaliser ou plus précisément à mettre fin à la concession par décret. Le gouvernement a terminé la concession et donné une indemnisation. Mais ils n’ont pas pu fixer une indemnisation. La société Aminoil a demandé un arbitrage. Il n’y avait pas d’institution prévue dans l’accord de la concession. Le texte n’était plus valable parce qu’une des concessions des années 30-40, où l’autorité, la « Appointing Authority », comme on dit dans le langage de l’arbitrage, était le représentant de sa majesté britannique à Bahreïn, un poste qui n’existait plus. La clause arbitrale ne prévoyait pas une possibilité pour l’arbitrage. Sous l’influence du gouvernement américain, le Koweït a accepté un compromis pour constituer un tribunal arbitral dirigé par un président nommé par la Cour international de justice et deux co-arbitres (chaque parti nomme un arbitre). Le Koweit avait nommé notre cher professeur Hamed Sultan comme co-arbitre, la société Aminoil, avait nommé Fitzmaurice, l’ancien président de la Cour international de Justice qui a participé au nom du gouvernement britannique à la création des Nations Unies, un personnage éminent. Le président de la Cour internationale de justice a nommé Paul Reuter de l’université de paris comme président. J’ai eu la charge dans cette affaire de plaider la légalité de la nationalisation et les effets de la nationalisation. C’était un travail énorme qu’on a conduit avec toute une équipe formée de représentants du gouvernement koweïtien qui avaient travaillé durant de longues années au sein du cabinet « Freshfields». Les instructions du ministre étaient, pour ma part, de travailler sur la légalité de la nationalisation et ses effets. Ça m’a pris plus d’un an pour mener à terme les trois soumissions présentées pour plaider à Paris. Durant cinq jours, je plaidais devant les illustres membres de ce tribunal arbitral. Il me semble que les points que j’avais évoqués pour défendre la légalité de la nationalisation étaient bien reçus parce que j’insistais sur l’application du droit international en tant qu’il faisait partie du système juridique au Koweït. Selon la constitution koweïtienne, le recours au droit international est nécessaire. J’ai axé ma paidoirie sur la décision et la résolution prise par l’Assemblée générale des Nations unies en 1961 sur la souveraineté permanente de l’Etat sur ses ressources naturelles. Une règle coutumière internationale qui autorise l’Etat à nationaliser pour mettre fin au système qui existait sous la colonisation. La condition était d’indemniser de façon juste. Ça a été repris à l’unanimité par ce tribunal qui a considéré la nationalisation entreprise par le Koweit comme légitime et ….. et les conséquences, une indemnisation juste.
Pour moi, une indemnisation juste devait prendre en considération les espérances des partis au moment de la nationalisation. La société américaine avait soumis des consultations, des rapports, des experts qui voulaient se baser sur les bénéfices qu’ils auraient réalisé jusqu’à 2008. Ils ont fait des calculs selon ce qu’on appelle dans le langage courant « discounted cash flow method » comment on aurait réalisé des profits en terme de dollars actuels au moment du procès, et ils réclamaient plus que 3 milliards de dollars. A l’époque, 3 milliards de dollars était une somme énorme. J’ai plaidé qu’il fallait voir la valeur des biens, et les comptables ont fait les calculs. Ce qui était sur le terrain valait entre 160 et 180 millions de dollars. La valeur du contrat devait être appréciée et évaluée selon la situation qui existait à l’époque de la nationalisation et j’ai soumis des procès-verbaux, des entretiens, des réunions qui ont eu lieu entre les représentants de la société Aminoil et le gouvernement koweïtiens. A la fin de longues réunions on est arrivé à une proposition de la société Aminoil de renoncer à leurs concessions contre un contrat de service où ils prenaient chaque année 10 millions de dollars net (hors taxe). En d’autres termes 100 millions de dollars, la valeur qu’ils estimaient leur être due. Le tribunal arbitral a tenu compte de mes plaidoiries dans ce domaine-là pour arriver à une solution. Ils n’ont pas besoin d’une deuxième phase pour discuter du quantum de l’indemnisation due. Ils avaient les éléments nécessaires pour arriver à une solution finale. La sentence finale a été rendue en mars 1982. La société Aminoil a reçu à peu près 230 ou 240 millions de dollars et le gouvernement koweïtien a exécuté la sentence.
Les commentaires des avocats d’Aminoil disaient que c’était un arbitrage amical où tout s’était déroulé dans les meilleurs termes. Il me semble que la société Aminoil et le gouvernement koweïtien étaient satisfaits. Mes efforts dans l’affaire des pyramides en Egypte et l’affaire Aminoil m’ont permis de devenir soudain un personnage important dans la communauté des arbitres internationaux.
Beaucoup d’invitations m’ont été faites pour parler ou devenir membre de l’association internationale de l’arbitrage commercial, ICCA (International Council for Commercial Arbitration), c’était un club très fermé, une trentaine de membres, et j’étais invité à en devenir membre, ce qui m’a vraiment surpris. Ce club privilégié d’arbitrage était composé essentiellement de juristes éminents et des arbitres de l’Europe, des États-Unis et du bloc soviétique. Le tiers monde n’était pas représenté et moi j’en étais le premier représentant. Il y avait aussi un membre nigérian très éminent à l’origine de cette initiative. Je me suis trouvé au milieu des activités dans ce domaine.
-L’institut de droit international
Une chose étonnante m’est arrivée après. En quittant l’université, et le cours que j’ai fait à l’Académie de droit international, je croyais que ma carrière comme juriste internationale terminée. Mais pour vous dire la vérité, j’étais surpris en 1987, alors que j’étais candidat égyptien pour devenir membre de l’institut de droit international, j’ai été élu dès le premier tour comme membre de cette illustre institution qui englobe pas plus que 130 professeurs et spécialistes du droit international soit privé soit public dans le monde entier. C’était peut-être la chose la plus impressionnante pour moi. J’ai appris que ce ne sont pas seulement mes écrits ou mes publications à l’Académie qui m’ont valu cette honneur mais un collègue, un confrère (on appelle les membres de cette confrérie, un confrère), le juge polonais, vice-président de la Cour, m’a fait la confidence suivante : « Ahmed, tu sais, j’ai appuyé ta candidature pour devenir membre et au moins 23 personnes ont suivi mon conseil. On m’a demandé si je connais Ahmed El Koshery et ma réponse était la suivante : Comme le fils de ce juge était marié à la fille de Fitsmaurice , dans un diner quelques semaine après les plaidoiries à Paris dans l’affaire Aminoil, Fitzmaurice a dit « ce jeune égyptien qui a plaidé devant nous aura un avenir brillant dans le droit international » et j’ai répété les remarques de Fitzmaurice, qui était mort à l’époque en 1987, il m’a dit qu’au moins 23 membres de l’Institut étaient influencés par ces mots gentils attribués au juge Fitzmaurice à mon égard.
C’était une surprise bien agréable. Au sein de l’Institut de droit international, j’ai rencontré des gens épatants et j’ai assisté à des réunions qui m’ont permis d’être à la page sur le plan des études de droit international et les questions d’actualité, les rapports et les discussions. C’était une prolongation de ma vie académique sur un plan tout à fait privilégié. Beaucoup d’affaires sont venues après, dans lesquelles j’ai participé comme conseil ou pour donner des avis juridiques sur le régime juridique égyptien et d’autres pays arabes ou comme arbitre ou président de tribunal arbitral. Une des choses très importante et que je dois signaler, c’est le premier recours d’une sentence arbitrale rendu sous l’auspice de ce qu’on appelle le CERDI Centre pour les disputes des investissements qui dépendent de la Banque Mondiale créé par la Convention de Washington de 1965. Le premier recours était dans une sentence rendue dans une affaire connue comme « Clockner contre Cameroun ». Le comité ad hoc, qui était en charge de voir si cette sentence devait être annulée ou non, était présidé par un homme remarquablement et mondialement connu : le professeur Pierre Laly, qui était aussi une lumière, un autrichien qui a enseigné à Bonn et dans beaucoup d’universités et moi comme membre aussi, ça m’a ouvert les yeux sur les contentieux des investissements et l’annulation d’une sentence qui a été rendu par un ancien président de la cour international de la justice avec deux autres membres, un homme d’Etat américain, William Rogers. Ma voie dans les contentieux dans les investissements, débutait mais j’ai participé à pas mal d’affaires comme arbitre ou président de tribunal arbitral par la suite. C’était aussi un volet des activités qui m’ont fait acquérir des connaissances dans des études surtout lorsque les grands cabinets plaident. On nous soumet une quantité d’ouvrages et de référence d’Authorities, comme on dit, soit judiciaires soit doctrinaires, et vraiment ça prend des semaines et des semaines à digérer, c’était une source d’informations très intéressante.
Deux autres domaines qui n’étaient pas prévu du tout quand j’ai quitté l’université.
– Affaire Lockerbie
La première, en 1991, j’étais appelé à devenir un juge ad hoc à la cour international de justice dans les deux affaires Lockerbie que la Libye a intenté contre les USA et la GB devant la cour internationale de justice. C’était une surprise totale pour moi, je savais qu’il y avait un attentat contre l’avion Pan American trois ans avant, simplement mes connaissances venaient de mes lectures de journaux, de la presse. Mais soudain, un jour au début de l’année 1991, le greffier de la Cour internationale de justice m’a téléphoné pour me dire « monsieur, vous devez venir demain pour prêter serment comme juge ad hoc dans cette affaire-là » Je ne savais pas du tout parce que, honnêtement je n’ai aucun contact avec le gouvernement libyen et je peux ajouter que je n’ai pas d’admiration ou de sympathie à l’égard de ce gouvernement-là. Je n’ai jamais mis les pieds en Libye. Ça restait pendant quelques semaines un secret mais je suis allé pour participer à la première phase des mesures conservatoires demandées dans cette affaire.
Devenir un membre de la Cour international de justice, même pour une affaire ou deux affaires, comme juge ad hoc, était une expérience d’une importance capitale. Ça marque l’individu. Deux remarques que je dois faire : je n’étais pas du tout approché par n’importe qui et ma contribution à la première phase qui a été guidé par mes études juridiques. J’arrivais à la conclusion que ni la GB ni les USA ne pourraient garantir un procès équitable aux deux inculpés libyens. Cependant, la Libye ne pouvait pas avoir le droit de juger ces gens-là parce la Libye ne peut pas être juge et partie. Selon les règles du droit international général et surtout en s’appuyant sur des principes généraux de droit musulman, personne ne peut être juge dans sa propre affaire. C’est pour cela que dans mon opinion au recueil de la Cour internationale de justice, j’ai dit « il ne faut pas livrer les deux inculpés ni aux USA ni à la GB, parce qu’on ne peut pas garantir sous le régime de juré que, les jurés sont sûrement influencés par les aspects politiques et la propagande et la publication et j’ai proposé qu’ils soient jugés devant des juges professionnels et hors les trois pays ». Une solution que j’avais proposé comme ça a été la solution adoptée sept ans plus tard quand le blocus aérien qui a été imposé sur la Libye n’a pas été respecté par les pays africains et les autres, les USA et la GB ont accepté, si tardivement, qu’on juge les deux inculpés devant un tribunal composé de lords écossais mais en Hollande, c’était exactement la solution que j’envisageais sept ans auparavant.
Ce n’est pas par amour propre mais je pense que c’était le seul moyen de sortir de l’impasse que ni les USA, ni la GB ni la Libye ne pouvaient garantir un procès équitable aux deux inculpés. Voilà c’est une affaire qui a duré jusqu’en 2003 où ça a été retiré de la Cour internationale de justice. Durant cette période-là, j’étais juge ad hoc devant la Cour internationale de justice. Ça c’était une affaire que je n’oublierai pas, je crois que ma conscience est tranquille, que j’ai saisi la ligne qui devait être appliquée. J’étais critiqué bien sûr par la presse, par le gouvernement libyen « Comment ? Le juge ad hoc nommé par la Libye dit que la Libye ne peut pas garantir un procès équitable à ces deux inculpés ? » J’étais sûr de moi. Je n’avais pas changé de convictions même si, on disait que je devais être liquidé parce que j’étais un traître. Ça ne me gênait pas du tout, j’ai fait mon devoir.
Une chose pour vous montrer comment notre Monde arabe fonctionne. Après avoir été à La Haye, un jour au Caire, j’entrais dans un hôtel, un grand hôtel au bord du Nil, je rencontrais mon ami et co-élève à la faculté de droit du Caire, Osama El-Baz, qui était à l’époque un homme très important, le collaborateur le plus proche du président Moubarak. Osama et moi étions à la faculté de droit de la même promotion, on se connaissait très bien. Il m’a posé « comment les choses sont allées à La Haye ? »Je lui ai dit «Mais, oui, ah bien sûr, tu es au courant que j’ai été nommé ? » Il m’a dit : « Mais Ahmed, c’est moi qui suis à l’origine de ta nomination ». Je lui ai dit « Mais explique-moi comment ?! » Il m’a dit que le président Khadafi a eu un coup de fil avec le président Moubarak, en lui disant, « j’ai simplement été informé hier que nous devons nommer un juge ad hoc à la cour selon le régime de la Cour, parce qu’il y a un juge permanent britannique, un juge permanent américain et nous avons le droit de nommer un juge ad hoc de notre culture juridique mais il n’y avait personne en Libye avec les qualités nécessaires, donc il faut me donner le nom d’un égyptien » et Moubarak a dit « bon je vais étudier ça,», mais selon Osama Al-Baz, Khadafi a dit « noooon je dois avoir la réponse maintenant, demain est le dernier jour pour répondre à la Cour, il faut me donner une réponse maintenant »
Sur ce, Osama est rentré chez Moubarak. Osama lui a dit « peut être quelqu’un qui était parmi les gens qui ont défendu l’Égypte dans l’affaire Taba », Il a donné trois noms, selon Osama : Georges Abi Saab, Nabil el Arabi et mon nom. Khadafi a dit non « Non, Georges Abi Saab était juge ad hoc dans l’affaire Tchad contre nous, donc exclu. Nabil el Arabi est votre ambassadeur à New York, on n’a pas le temps, on ne peut pas l’avoir ».
En d’autres termes, les révélations d’Osama m’ont démontré comment les choses dans notre monde arabe ne passe pas d’une manière scientifique ou d’un choix délibéré mais que quelqu’un, un président, demande à un collègue de lui donner des noms et il prend les suggestions en définitive. Et voilà et si ça marchait en ma faveur dans cette affaire-là, mais ce n’est pas du tout une bonne méthode que je pourrais recommander qu’on utilise. On doit avoir des études sur les gens disponibles. Et je suis sûr et certain que dans l’ensemble du Monde Arabe, il y a des gens peut être mieux qualifiés que moi, et le choix doit être fait selon des critères objectifs et une analyse qui ne prend pas en compte les rapports personnels avec tel ou tel individu. Ceci me mène à deux autres choses que j’aimerais bien dire dans ce domaine.
– L’affaire Taba
J’avais eu aussi la chance inouïe d’être choisie comme membre de l’équipe qui devait défendre les intérêts de l’Egypte dans l’affaire Taba ; c’était en 1986, et la décision a été rendue en octobre 1988, donc deux ans et demi après. Pour avoir une idée de cette affaire-là, Israël s’est engagé à évacuer le Sinaï en fonction des accords de paix avec l’Égypte, en application des accords de camps David. Le 6 octobre 1981, le président Sadate est assassiné et ceci a posé une question dans les esprits des dirigeants israéliens. Devaient-ils vraiment aller de l’avant pour exécuter la deuxième phase de l’évacuation en avril 1982 ? Ayant quelques hésitations sur la personnalité du nouveau président, il y a eu un changement dans la politique, ceux qui travaillaient en harmonie avec l’époque égyptienne, comme M. Azra Wiseman, le ministre de la défense de l’époque, un très grand ami de Kamal Hassan Ali, le ministre égyptien, les rapports étaient cordiaux. Ils ont changé. Ariel Sharon a été nommé Ministre et a dénoncé certains résultats obtenus auparavant, entre l’Égypte et Israël. Des résultats techniques, qui précisaient les endroits pour la frontière entre les deux pays. Ils ont disait « non non non, des fautes ont été commises, nous retirons notre accord sur 14 piliers » (ces endroits où des piliers devaient être mis). On voyait les raisons politiques derrière cette volte-face intervenue juste après l’assassinat du président Sadate. Les américains n’étaient pas contents et ils ont conclu un accord temporaire pour qu’Israël évacue jusqu’à un point considéré en territoire égyptien. Le reste était contesté par Israël et les égyptiens. Ce n’était pas la bonne démarcation des frontières. Une phase ultérieure s’est ouverte et on a négocié un arbitrage.
Il a fallu presque 4 ans pour aboutir à un compromis d’arbitrage. Un tribunal arbitral devait être formé. Il était composé de 3 personnes neutres ni Egyptiens ni Israéliens. Un arbitre égyptien a été nommé par l’Egypte et un arbitre israélien par Israël. Israël a nommé une dame, professeure de droit international à Tel Aviv comme arbitre, l’Egypte a nommé le professeur Hamed Sultan, notre professeur de droit international privé, comme arbitre. Le choix des trois neutres se faisait de la manière suivante : chaque pays, Egypte, Israël et les États-Unis, devaient présenter une liste de 10 noms. Si un nom était sur les 3 listes, il passait. Comme ça on aurait trois noms incontestés. Le résultat des trois listes a abouti à la nomination de deux personnes : Pierre Bellet, l’ancien président de la Cour de Cassation en France, d’une intelligence remarquable. Il avait été un des juges irano-américains à La Haye où il a eu une contribution très importante. L’autre, Schendler était professeur de droit international à Zurich de nationalité suisse. Il n’y avait pas de troisième membre. Le Professeur Bellet était considéré comme le président et a proposé dans sa façon tout à fait ouverte : « Pourquoi vous n’avez pas choisi Algringen Le président du Tribunal irano-américain avec lequel j’ai travaillé au moins trois ans ? » Bellet a informé les deux partis qu’il n’aimait pas les fonctions administratives et que Algringen était un meilleur président. Bellet a accepté d’être arbitre mais pas président et il a demandé aux partis de reconsidérer leur décision et les deux pays se sont mis d’accord pour avoir Algringen comme le troisième membre du tribunal arbitral et comme président. Moi j’ai été choisi comme membre de l’équipe de l’Egypte pour plaider dans cette affaire-là. Bien sûr le travail qui a été fait était un travail collectif. Et pour la première fois, l’Egypte a réussi à avoir une équipe bien soudée dans ce domaine-là. Sans me donner de l’importance, j’avais proposé au ministre des affaires étrangères, Docteur Naguib, de faire appel à des juristes étrangers spécialisés et à un cabinet qui avait l’expérience des tribunaux arbitraux internationaux. Mon conseil a été retenu et on a pu faire appel à Derek Bowett, professeur de droit international public à Cambridge University en Angleterre. Nous avons aussi fait appel à M. Sinclair, ancien conseillé des affaires étrangères britannique. Les deux nous ont aidé dans cette affaire, surtout Mr. Sinclair. Il nous a ouvert les portes des archives britanniques qui étaient très importantes pour la documentation qui n’était pas en possession de l’Egypte au moment de la signature du compromis d’arbitrage.
On a choisi le cabinet des « Frères Cholmeley »qui eux s’occupaient de ça. J’ai vu comment ils travaillent, pour nous aider à la présentation et la préparation des tableaux, des documents nécessaires. Ça a été bénéfique, pour la première fois, l’Egypte a été en mesure d’utiliser la technologie la plus moderne dans sa présentation et nous n’avons pas eu les problèmes qu’on rencontre normalement dans nos tribunaux ou notre Administration. C’est un travail que nous avons fait ensemble mais le moment de la vérité est venu à l’oral, pour les plaidoiries. Dereck Bowett a dit qu’il était la contrepartie de quelqu’un recruté par Israël pour plaider simplement le dernier point sur le golfe d’Aqaba et qu’il ne voulait pas s’occuper des treize autres piliers contestés. Mes autres collègues, membres de l’équipe pour des raisons qu’ils ont évoquées, n’étaient pas prêts à le faire également. Dès qu’on m’a choisi comme membre de l’équipe, j’ai consacré tout mon temps (à peu près 18 mois) à cette affaire. J’utilisais la méthode habituelle, celle d’un étudiant de deuxième ou de troisième année. J’ai lu toute la Littérature concernant les conflits des frontières et surtout sur l’affaire de Kishenganga entre le Pakistan et l’Inde, et c’est une affaire énorme qui concernait des centaines de km, et j’avais étudié ça comme un cours de doctorat. Je n’étais pas en mesure de dire non comme mes autres collègues quand on m’a demandé de plaider les 13 piliers. J’ai donc accepté cette tâche. C’était une tâche difficile parce que des rumeurs circulaient, les États-Unis avaient une équipe de douze juristes aux affaires étrangères qui étudiaient les mémoires égyptiens et israéliens. Ils sont arrivés à la conclusion que l’Egypte allait gagner l’affaire. Et sur ce, Shultz, qui était au State Department américain avait changé de juriste – Abraham, qui était très lié à Israël, parce que son beau-père donnait des contributions régulières à Israël tous les ans – pour trouver une solution qui épargnerait Israël. Des rumeurs circulaient à l’époque. Le président Moubarak aurait dit « non, on a accepté l’arbitrage, on ne fait pas de concessions ou de transactions ». Chamir, qui était de l’autre côté, à l’époque, disait qu’il était conscients que les égyptiens, avec l’aide des étrangers, avaient fait une bonne présentation mais qu’il nous aurait à l’oral. Qu’il allait nous mettre en difficulté et gagner. On sentait que c’était une phase difficile mais ça ne m’a pas du tout effrayé et j’ai accepté de plaider pour l’Egypte, les 13 piliers. Le 14e a été plaidé par Derek Bowett. Heureusement, la décision a été presque unanime. La dame israélienne a été la seule à dire non. Les quatre était pour. La phase sur Ras al Naqab, la partie des montagnes, était stratégiquement très importante et on a gagné sur celle-ci. Le critère que j’avais proposé au tribunal pour la partie désertique a été accepté. Le tribunal ne pouvait pas trancher entre les deux. J’ai proposé que nous fassions, comme pour les travaux de 1906 au moment de la première démarcation, un tracé via des postes télégraphiques (sortes de lignes droites). On a suivi cette solution en accordant la préférence à la partie la plus proche de la ligne. Pour Israël, bien sûr, le point était plus proche sur 3 ou 4 piliers avec une distance maximum de 2, 3 ou 4m mais sur l’essentiel c’était l’Egypte qui gagnait, presque 3 km² dans l’ensemble de la partie désertique et 7 km sur la hauteur. Bref c’était un succès et en tant qu’égyptien, j’étais fier de pouvoir faire ça à mon pays. Les membres égyptiens n’avaient pas touché un seul sous. C’était un travail qu’on faisait comme bon citoyen pour notre patrie. Ça m’a donné un plaisir énorme.
Quand a émergé le conflit entre le Yémen et l’Erythrée, sur la souveraineté des îles entre les deux pays, j’ai été choisi comme un des cinq membres du tribunal arbitral en charge de se prononcer sur la souveraineté des îles au sud de la mer rouge et pour la démarcation de la frontière maritime entre les deux. C’était une expérience inouïe pour moi car j’étais confronté à des difficultés avec d’illustres membres choisis par l’Erythrée. Parmi eux il y avait Stephen Schwebel, l’ancien président de la Cour internationale justice et l’illustre dame, Rosalyn Higgins. Elle était professeure puis est devenue juge et présidente de la Cour internationale de justice. Schwebel et Higgins étaient de bons choix. Du côté du Yémen, on a choisi deux personnes : un personnage américain très bien, Keith Hayyat, un juriste connu et moi-même. Nous devions choisir le président du tribunal arbitral. L’Erythrée n’a pas accepté qu’on ait un président français. C’était normal parce que les accords d’arbitrage ont été négociés en France. La dame qui représentait l’Erythrée a dit : « ce sera Sir Robert Jennings, l’ancien président de la Cour internationale de justice, et c’est irrévocable ». On ne pouvait pas refuser la nomination de Sir Robert Jennings, il a été choisi. C’était un homme remarquable. C’était la première fois que je travaillais avec lui mais je savais que c’était un juge illustre. A nous cinq nous sommes arrivés à une solution unanime sur la question de la souveraineté, les plaidoiries n’étaient pas suffisantes. Le Yémen avait une présence plus importante sur les iles que l’Erythrée et c’est comme ça que le Yémen a eu la main haute dans la détermination de la souveraineté sur les îles. Dans la deuxième phase, on est arrivé à une ligne équitable, la plus droite possible pour les deux pays, mais en tenant compte des droits de la pêche et des gens qui venaient des deux côtés de la Mer rouge. J’étais instrumental, en démontrant que la règle applicable durant des siècles. Le droit musulman était applicable des deux côtés. Les deux pays dépendaient de l’Empire Ottoman, qui appliquait les règles de droit musulman, et il y a une règle qui considère le droit des pêcheurs à avoir des ressources en commun. Les livres d’Histoires que j’ai étudiées démontraient que les pêcheurs du côté érythréen avaient l’habitude de pêcher tout près de ces îles-là, pour vendre le produit de leur pêche sur la côté yéménite. On a maintenu ce droit en faveur des pêcheurs érythréens. Notre deuxième solution comme la première a été adopté à l’unanimité. Nous travaillions avec d’illustres juristes dans cette affaire-là, dans un domaine qui n’était pas le mien. J’ai appris beaucoup de choses sur les délimitations maritimes, sur la souveraineté, sur les iles, durant ce travail qui m’a pris presque deux et demi et qui m’a été d’un intérêt remarquable.
– Réforme des Nations Unies
En 2006, j’étais informé par le conseiller juridique des Nations Unies que j’étais choisi un parmi 5 membres de ce qu’on appelait le « Redesigned Panel » pour la réforme intérieure des Nations Unies. Il y avait beaucoup de plaintes des fonctionnaires des Nations Unies, à Washington et ailleurs, sur le continent africain, asiatique, ou même Amérique Latine. Ils se plaignaient que leurs droits n’étaient pas sauvegardés comme il le faut, selon les normes juridiques. Le Secrétaire général des NU sous une décision de l’Assemblée générale a choisi 5 membres. J’étais parmi eux, pour faire cette réforme. On est resté à New York durant six mois, en écoutant les gens, en étudiant les rapports pour arriver à un rapport. Ça touchait plus de 80.000 personnes donc c’est la réforme dans des institutions globales, mondiales, et spécialisées des Nations Unies. J’avais la chance d’avoir deux dames remarquables, une dame australienne qui était juge dans son pays et membre du tribunal de l’Organisation du Travail à Genève et une juge canadienne. Il y avait un ancien ministre et professeur en Uruguay et un jeune nigérien qui avait l’habitude de travailler aux Nations Unies. Il a eu une part importante dans le tribunal contre le génocide au Burundi. Nous avons travaillé en équipe pour arriver à proposer une réforme qui a été acceptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Je crois que ça a mis fin à beaucoup d’irrégularités qui existaient auparavant, qui sauvegardaient les droits de la défense et de la préparation équitable et égalitaire des gens qui ont par leur profession un rôle important dans le maintien de la paix et du développement dans le monde. Ce fait là m’a donné beaucoup de plaisir. Voilà un rôle non seulement pour adjudiquer des affaires personnelles mais pour mettre une réforme sur les règles applicables.
La continuation de ce travail aux Nations Unies m’a valu d’être nommé par le président de la Banque mondiale comme un juge administratif de la banque mondial. Un poste que j’occupe jusqu’à aujourd’hui. C’est la continuation de ma vie professionnelle, qui peut être justifie mon désir d’enfant d’être juge, juge ad hoc à la Cour international de justice, juge au tribunal administratif de la BAD (Banque Africaine de Développement), et actuellement à la Banque mondiale. L’exemple de mon grand-père, a inspiré mon désir de devenir étudiant de droit. Ce désir s’est réalisé en partie en étant M. Le juge Al Koshery, juge actuel au tribunal administratif de la Banque Mondiale. Voilà, grosso modo les étapes importantes dans une vie professionnelle qui, je le croyais au moment où j’ai quitté l’université était fini alors que mes démarches académiques pour le service de droit se sont prolongé plus de trente après, d’une façon qui m’a été profitable.
– Création de l’Université Senghor
Un aspect que j’ai délibérément laissé à la fin, c’est l’expérience de la création de l’Université Senghor à Alexandrie. Mon cher maitre, professeur René Jean Dupuy, avait un projet d’université destinée à éduquer les jeunes futurs cadres africains. Ce projet a été envisagé par Leopold Sedar Senghor, Maurice-Dorion, le Secrétaire permanent de l’Académie française, le professeur Dupuy et par Boutros Boutros-Ghali. Le but était de donner la possibilité aux jeunes africains de devenir de meilleurs cadres administrateurs pour le développement économique et social de leur pays. On a choisi Alexandrie comme siège de cette université qui eut le nom de « l’Université de langue française au service du développement africain », et comme il est très long, j’ai proposé dès le début qu’on la baptise, l’Université Senghor d’Alexandrie. Elle est devenue célèbre comme ça parce que Senghor était un des hommes qui a eu la vision de la nécessité de créer un endroit où les jeunes africains pouvaient se réunir et avoir une formation commune. Cela aura facilité les rapports entre plusieurs pays africains, surtout francophones. C’est Senghor qui a dit : « La route de la civilisation a commencé en Afrique, en passant par l’Egypte pour illuminer le continent européen qui était à l’époque sans culture. Dans le voyage de retour, rien n’est plus commode que de passer de la même façon par la science qui s’est développée en Europe et qui devait retourner en Afrique, via Alexandrie, comme dans le voyage du commencement de la civilisation ». Voilà peut-être la raison qui m’a incité à donner le nom de Senghor car il symbolise ce passage de connaissances de l’Afrique à l’Europe. Une fois développée en Europe, elles devaient faire leur voyage de retour en Afrique. J’ai enseigné comme vice-président de cette université durant trois ans le droit économique international, les branches qui concernaient des composants juridiques, une partie du curriculum et j’avais organisé des rencontres avec beaucoup d’organisations, surtout dans le domaine de l’investissement et de l’assistance technique. Je suis restée après le décès du président Dupuy en tant que son successeur pendant presque six ans, et j’ai accompli ma tâche à l’université Senghor. J’ai fait de mon mieux pour la réussite de cette université en insistant sur une chose que je ne regrette pas : que le Conseil d’Administration de l’Université soit une organisation académique. Je comprends très bien que les bailleurs de fond veulent avoir la main haute sur la destinée de l’Université mais je n’étais pas du tout en faveur de leur implication dans l’Administration de l’Université. J’ai fait de mon mieux durant mes années de service à l’université de Senghor. Je n’ai pas profité d’un sous parce que mes services à l’Université Senghor étaient bénévoles. Je n’avais pas de traitement et je n’ai pas accepté d’être mêlé aux activités financières de l’Université de mes débuts jusqu’au moment où je suis parti. Voilà, mon parcours.
Je n’ai jamais accepté que l’université me procure de voiture. J’utilisais ma propre voiture et j’avais fait tout ce que ma conscience me dictait à l’égard des jeunes étudiants et des jeunes fonctionnaires très mal payés. Si vous croyez à une fonction, rien de plus commode que de faire des sacrifices et les sacrifices financiers sont les moindres. Quand vous êtes convaincu qu’il y a une mission à accomplir, c’est un plaisir de faire les sacrifices nécessaires pour les accomplir.
QUESTIONS
Personnalités qui ont marqué le plus ma vie :
Pour ma vie privée, ma mère, mon père et mon oncle m’ont beaucoup influencé. Mon oncle était un exemple d’humanisme de notre village en Haute- Egypte, il m’a donné ma première leçon de tolérance (le baise-main au prêtre copte, tout comme au cheikh qui enseignait le Coran).
Pour ma vie professionnelle, les personnes suivantes :
– Le cheikh Abdel Wahab Khalaaf, professeur à l’Université du Caire, dont je me souviens encore de ses paroles dans l’amphithéâtre
– Amin Badr, qui m’a demandé d’aller à Paris et qui avait un sens d’appréciation de la bonne vie remarquable
– Sanhoury Pacha
– Francescakis, qui m’a appris à rédiger un article digne d’être publié dans la Revue critique de Droit international privé
– René Jean Dupuy, son esprit humaniste, son intelligence, et sa générosité d’âme
– Philippe Kahn, devenu un frère pour moi dès notre premier séjour à La Haye en 1968 et ses sacrifices pour la science
Événements qui ont marqué ma vie :
L’attentat contre Sanhoury m’a démontré que la démocratie est une bataille. Celui qui se bat pour la démocratie peut se faire agresser physiquement. Après ça, je suis resté très attaché à la règle de droit, au respect de la légalité, la nécessité d’être dur contre l’impunité des gens qui ont fait du mal à l’Égypte. Il faut faire respecter la règle de droit par la sanction judiciaire. C’est terrible de voir des gens qui ont commis tant de crimes contre le pays vivre en toute impunité. Il faut une justice rapide, efficace et exemplaire c’est le moyen pour sauvegarder la suprématie de la règle de droit.
Les livres qui ont eu beaucoup d’influence sur ma personnalité :
– Le phénomène humain, Pierre Teilhard de Chardin, un jésuite qui était en Egypte dans sa jeunesse. C’est un savant, il a publié cinq livres. J’ai lu tous les cinq mais c’est « Le phénomène humain » qui m’a frappé où il reste religieux, croyant à Dieu mais il démontre le progrès. L’humanisme est quelque chose de très important. C’est un ouvrage qui m’a ouvert les yeux sur le véritable sens de la religion. Celui d’aimer votre voisin, faire le bien même à l’égard de ceux que vous ne connaissez et envers vos propres ennemis. Il faut avoir cette tolérance, cette acceptation de l’autre et comprendre que la religion n’est pas un atout pour lutter contre les autres religions, les autres idéologies mais pour apprécier des façons différentes de réfléchir. C’est aussi le respect des autres.
– Parmi les centaines de livres que j’ai lus en France, parmi les livres de droit, il y avait des auteurs très importants : Raymond Aron et Maurice Duverger.
– Un des livres qui a joué un rôle important c’est : Les mains sales de Jean Paul Sartre. Ça a été une source d’inspiration pour ne pas m’engager dans la politique politicienne c’est-à-dire la vie des politiques parce que vous ne deviendrez pas maître de vous-même. Pour conserver votre personnalité, votre individualité ne pas être intégré par la politique ne vous fera pas accepter des choses contre votre conscience.
Loi égyptienne sur la loi d’arbitrage n°27-1994
Quand j’étais lancé dans le domaine de l’arbitrage, j’avais beaucoup de choses à apprendre. J’ai essayé de suivre le mouvement international et d’envisager la réussite de l’arbitrage international. Il nécessite des règles communes adoptées dans plusieurs pays du monde. En voyant comment quelques décisions de la justice égyptienne étaient mal placées avec des effets très néfastes, j’avais proposé qu’on prépare une réforme sur nos règles d’arbitrage. A l’époque, je connaissais le ministre de la justice en Egypte, docteur Mamdouh bey Atteya. Nous nous sommes confrontés non seulement avec l’affaire des pyramides et beaucoup d’autres affaires pour avoir l’équipement juridique nécessaire. L’Egypte avait ratifié la convention de New York sur l’exécution des sentences arbitrales mais elle n’était pas applicable. J’étais le premier à évoquer cette convention devant les tribunaux égyptiens qui ont eu du mal à comprendre le sens de la convention et à l’appliquer convenablement. Mamdouh bey Atteya, le ministre à l’époque et son successeur, Farouk Seif Al Nasr, ont accepté qu’on nomme un comité pour étudier la réforme, et sans hésitation c’est Mohsen Chafiq qui nous a dirigé. C’était un grand maître en droit commercial, l’équivalent de Sanhoury en droit civil, quelqu’un de remarquable, d’intelligent, et le premier égyptien fondateur de la commission des Nations Unies sur le droit du commerce international. Il a présidé la conférence d’Hambourg sur les règles du transport maritime. Il était professeur à Alexandrie initialement mais il est venu au Caire plus tard. C’était un homme calme mais très savant qui a fait ses études en France dans les années 1930, dix ans après Sanhoury. Il avait une intelligence rare et c’est lui qui a présidé. Docteur Mohsen Chafiq dirigeait les études de Samia Rached, mon épouse, la regrettée Samia qui était professeure. Entre professeur et professeur adjoint, on donne des articles et des publications. Il était la tête des études, il admirait l’intelligence de Samia. Il voulait que Samia et moi fassions parti de l’équipe. Moi je préférais que ce soit Samia, surtout comme j’avais des affaires d’arbitrage, les gens pouvaient dire, « voilà, ils veulent introduire des règles qui servent leurs intérêts ». Moi j’ai dit, Samia est professeure, elle n’est pas arbitre, elle n’a pas d’affaires d’arbitrage donc elle sera plus objective. Samia a fait une partie avec Morsed Chafiq, moi, hors les formalités, j’avais mis toutes les connaissances nécessaires à disposition de Morsed Chafiq et Samia. A l’époque, il y avait le docteur Mohamed Abu Naïm qui dirigeait le centre du Caire. Il a créé cette Commission et en est devenu membre, le docteur Mohamed Abu Naïm a joué son rôle, il était en contact avec les autorités législatives et exécutives.
Le projet initial avait été proposé par Morsed Chafiq et Samia Rached. Il concernait l’arbitrage commercial international mais à l’Assemblée nationale les gens ont attaqué. « Pourquoi ? C’est une règle qui privilégie untel ou untel… » Ils ont mélangé les textes qui étaient initialement fait pour l’arbitrage international et les ont généralisés. Par exemple, la liberté du choix de la langue, français, anglais ou indien. On a même déformé, le titre de la loi devenu « la loi de l’arbitrage dans le domaine civil et commercial ». Cela a permis à certains éminents juristes et avocats de dire que ce n’était pas applicable aux contrats administratifs, donc les conflits de l’Administration ne tombaient pas sous le coup de cette loi. Des choses sont intervenues pour corriger les fautes introduites durant les débats parlementaires. On reste jusqu’à aujourd’hui à la merci des tribunaux pour corriger certaines fautes et c’est difficile tous les jours de changer et modifier la loi, elle n’est donc pas idéale. Mais mon rôle était limité à une sorte d’assistante technique à mon cher maître, le professeur Chafiq et ma chère épousé décédée, Samia Rached.
Il y a un problème énorme dans notre système juridique, nous avons une division entre droit des familles et droit des obligations. Pour le droit des familles, il est influencé par le droit religieux, c’est pour ça que je n’aimais pas du tout enseigner le droit à la famille à l’université. Je suis contre le fait qu’on utilise la religion pour changer le système politique applicable. Notre Cour de cassation a une jurisprudence constante. Si par exemple deux chrétiens orthodoxes se marient, et pour mettre fin à ce mariage, ils doivent devenir musulmans, surtout pour le mari, il peut divorcer par ses propres mots, la répudiation, sans aller voir le juge. C’est de la « fraude à la loi ». Tout le monde sait qu’il y a eu des fraudeurs, par exemple pour se débarrasser de son épouse. Ça a abouti à des catastrophes ! Donc moi pour éviter d’être en contradiction avec mes convictions profondes, j’avais refusé d’enseigner le droit de la famille et les règles du droit international privé dans ce domaine-là. Toutes mes activités et publications étaient sur le droit patrimonial (contrats, délits, responsabilités intellectuelles …) et dans ce domaine-là, je crois que nous devons avoir une codification plus détaillée. Certains pays ont fait ça. La Communauté Européenne a des règles très adaptées et à l’heure actuelle, la Conférence de la Haye pour la codification du droit international privé est en train de préparer une sorte de codification des règles adaptées parce qu’il y a des aspects nouveaux. Les règles de police et les règles de protection de la santé, beaucoup de choses se mêlent et il faut faire la distinction. Les rapports contractuels peuvent avoir un choix d’une loi quelconque en droit international ou d’une convention international ou des règles qui découlent de la pratique commerciale internationale. J’appartiens à l’école de Dijon favorable à l’application des principes généraux de droit et à la lex mercatoria. Si vous n’êtes pas d’accord sur le mot de lex mercatoria, il y a des traditions, des solutions qui ont été établi dans certains domaines qui établissent des règles, soit coutumières, d’usage de commerce international. Elles méritent d’être appliquées. Je suis un membre du groupe de travail à La Haye. Beaucoup de détails sont susceptibles d’être arrangés, dans les conventions internationales et beaucoup de modèles pour certains contrats ou des textes devenus habituels pour la stabilisation des textes juridiques. Quelles sont les limites des clauses de stabilisation, pour faire fonctionner d’une façon harmonieuse la stabilité contractuelle et les changements de circonstance. Nous avons deux faces d’une même pièce : pacta sunt servanda et rebus sic stantibus. Ce qu’on a accepté s’applique sauf s’il y a changement de circonstance. Les règles pour la protection, de l’environnement de la santé, de la défense nationale, la lutte contre les dangers écologiques ou maritimes. Il y a des règles qui doivent être suivies même si elles ne sont pas considérées comme des règles de l’ordre public international. Le champ est ouvert et nous devons permettre à nos juridictions de se développer. N’oublions pas qu’avant 1949, nos tribunaux n’avaient pas de compétence en droit international privé. C’était les tribunaux mixtes qui s’en occupaient. Il faut profiter de l’héritage des tribunaux mixtes. Or, il y a une rupture, on a commencé en 1949 et très peu d’affaires de droit international privé sont intervenues, surtout dans le domaine familial. On ne peut pas comparer la jurisprudence française ou allemande à la jurisprudence égyptienne. Il faut des juges spécialisés et une chambre spécialisée en droit international privé.
[1]En Arabe
[2]En Arabe