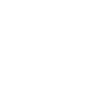Le phénomène d’appropriation des droits étrangers par les pays arabes : réussite ou échec ?
« Est perdant tout pays qui cherche à en imiter un autre. Il ne peut y avoir de ligne justifiée, dans un pays que dans l’intégration à soi-même ». Jacques Berques, Il reste un avenir, Arléa 1993.
La formation du droit moderne des pays arabes se résume en une conciliation plus ou moins réussie entre les codifications européennes et un droit local, coutumier, voire religieux. En Egypte, en Tunisie, deux pays dont les droits ont largement influencé celui des autres pays arabes, le désir de modernité juridique semble se confronter en permanence à l’impératif social du respect des normes d’un droit toujours local, traditionnel, parfois religieux. Il ne saurait, semble-t-il, y avoir de droit qui ne soit pas inspiré partiellement ou totalement du droit local dans les pays arabes. Le processus d’élaboration du droit est ainsi toujours semblable : une inspiration étrangère, essentiellement européenne, choisie pour sa modernité apparente, conjuguée avec les coutumes locales.[1]
Cette méthode est-elle pertinente ? La modernité – perçue à tort ou à raison – des législations européennes, peut-elle pénétrer si elle est en permanence confrontée aux coutumes locales? Plus important, peut-être, la liberté religieuse des citoyens nécessite-t-elle d’être figée dans le marbre de la loi ? Le droit peut-il être épris de liberté, donc moderne, et permettre une libre pratique de la religion ? Du reste, le droit occidental est-il le plus adapté aux pays arabes ?
La première tentative d’appropriation du droit étranger a été initiée par l’Empire ottoman (I), puis en droit des obligations par les législateurs égyptien et tunisien (II), sans qu’aucun ne s’interroge véritablement au sujet de la ratio legis (III).
I- Premières inspirations : l’Empire ottoman et la Turquie
La première grande vague d’inspiration des législations étrangères par les pays arabes coïncide avec le déclin de l’empire ottoman. Pour combattre ce déclin, le sultan Mahmoud II entreprend d’importantes réformes, dont des réformes juridiques. Cette ère dite des Tanzimat commença dès 1839. Pour faire de l’Empire un acteur important du commerce international et ouvert sur ses voisins, fut adopté en 1850 un code de commerce, copié en tous points sur celui de la France par Napoléon I. Cette même démarche fut étendue au Code pénal (1858). L’empire ottoman n’est pas isolé dans cette démarche d’appropriation des codes napoléoniens, dans la mesure où ceux-ci jouissent alors d’un rayonnement intellectuel international.
Quant au droit constitutionnel, l’Empire ottoman s’est également inspiré de modèles existants.
C’est en 1876 que l’empire ottoman se dote pour la première fois d’une constitution. Cela étant, son objectif n’est pas d’organiser et de fixer le fonctionnement de l’Etat ottoman. En effet, le contexte de crise politique explique davantage l’adoption de cette constitution. Non seulement plusieurs insurrections menacent la paix intérieure, mais une guerre avec l’Empire russe pouvant aboutir à un partage des Balkans semble imminente. L’adoption d’une constitution a pour objectif d’y remédier en pacifiant et en unifiant l’Empire.
Celle-ci est « octroyée » par le sultan Abdulhamid II au peuple ottoman : sa légitimité vient du sultan et de lui seul. La règle du parallélisme des formes voudra, bien sûr, que ce soit le sultan qui décide seul de son amendement ou de son abrogation. Cette idée d’octroi par le souverain a été empruntée au Royaume de Prusse. La Constitution vient donc consacrer cette unité entre le peuple, l’Empire et son souverain.
Pour ce qui est du contenu, c’est le modèle belge qui est le plus prépondérant. Sa tendance libérale doit cependant composer avec certains archaïsmes. Si l’égalité devant la loi sans distinction de religion est reprise, l’Islam demeure la religion de l’Etat. Certes, l’un n’empêche pas l’autre. Un droit peut instaurer l’égalité entre les citoyens de confessions religieuses différentes en n’accordant d’importance qu’à la qualité de citoyen au lieu de celle de fidèle dans un Etat doté d’une religion officielle. En revanche, la légalité des délits et des peines, l’inviolabilité de la personne, de l’honneur, de la propriété et du domicile se concilient difficilement avec la possibilité pour le souverain d’expulser de manière discrétionnaire quiconque du territoire. C’est donc, en l’espèce, moins la référence religieuse que la tradition despotique qui est en contradiction avec le droit étranger repris.
Mise en place pour renforcer l’unité de l’empire face à une guerre imminente, c’est très logiquement que la Constitution de 1876 sera abolie par le sultan, celui-là même qui l’avait octroyée, suite à la défaite militaire face à l’empire russe en 1878. Aussi simplement qu’elle fut mise en place, elle fut abrogée sur décision du sultan.
L’Empire ottoman s’effondre en 1923 et la république turque laïque est proclamée sous l’impulsion de Mustapha Kemal. Ce dernier entend traduire la laïcité dans le droit civil et fait alors traduire le code civil suisse, le modifie légèrement, pour ensuite le proposer au parlement. Par un vote quasi-unanime le code civil suisse est adopté par le nouveau parlement turc en 1926.
Cependant, à l’aune de la souveraineté retrouvée, la laïcité est peut-être moins une orientation politique qu’un moyen de faire disparaître définitivement le régime des capitulations. En effet, celles-ci sont des règles conventionnelles ayant pour objet de soustraire à la compétence territoriale de l’Empire ottoman et d’assujettir à la compétence personnelle des Etats européens le statut juridique de leurs citoyens domiciliés ou résidant dans l’Empire ottoman. Il y a une méconnaissance flagrante du principe de l’égalité souveraine des nations au détriment de la Turquie puisque les ressortissants européens, du fait de leur seule nationalité, continuent à échapper aux juridictions turques pour n’être soumis qu’à celle de leur Etat national.
Cette absence de référence religieuse n’empêche pas de légères adaptations aux mœurs turques : l’âge minimum du mariage est abaissé et le régime matrimonial de séparation de biens est préféré en tant que régime matrimonial légal au régime de la communauté de bien. En revanche, le mariage devient civil et monogame, le divorce judiciaire et l’action en recherche de paternité au bénéfice des enfants naturels permis.
Se pose alors la question suivante : la réception du code civil suisse dans une société profondément religieuse pouvait-elle se faire sans heurts ?
La réponse est partagée. Si les dispositions ne relevant pas du droit de la famille ont été globalement bien reçues, il en est autrement de celles relevant du statut personnel, et principalement le mariage. Les populations turques, surtout rurales, n’étaient ni désireuses ni préparées à de tels changements. Les habitants des campagnes d’Anatolie résistèrent sans frémir pendant plusieurs décennies en continuant à célébrer des mariages religieux par un échange des consentements devant deux témoins. Ces mariages donnant lieu à un grand nombre d’enfants illégitimes au regard du nouveau code civil, le gouvernement a dû revoir sa législation pour tenter de placer les enfants issus de mariages civils et de mariages religieux sur un pied d’égalité. L’instauration du mariage civil obligatoire en Turquie dès 1926 est le résultat d’un vote du parlement. Le mariage religieux, celui d’une révélation divine. Le premier n’empêche pas le second et vice-versa. Tout comme l’autorité étatique ne doit s’occuper que de la formation du mariage civil, le droit religieux ne doit s’occuper que du mariage religieux. Peut-être l’instauration d’un mariage civil aux effets rétroactifs à la date choisie par le juge national aurait pu être une solution, démontrant ainsi que mariage civil et religieux sont parfaitement cumulables. Quoi qu’il en soit, la méthode choisie – recopiage du droit occidental agrémenté de coutumes locales – démontre déjà son échec.
Quant aux pays arabes sous domination ottomane, l’exemple tunisien est intéressant puisque dès le 10 Juillet 1705, la Tunisie est parvenue à se libérer de la suzeraineté de l’Empire ottoman par la fondation de la dynastie Husseinite par Hussein ben Ali. En pratique, les différents Bey de Tunis pourront légiférer en toute indépendance des ottomans. Deux réformes législatives de grande importance verront alors le jour, le pacte fondamental de 1857 et la Constitution de 1861.
Le pacte fondamental de 1857 est une déclaration des droits de sujets du Bey de Tunis voulue par Mohamed Bey, le monarque tunisien, afin de proclamer l’égalité en droit, le respect de la personne humaine, l’inviolabilité de la propriété. Autrement dit, tous les sujets bénéficient des mêmes droits, sans qu’une appartenance confessionnelle ne puisse justifier un traitement différent. Le pacte fondamental a été adopté sous pression européenne, principalement des représentants consulaires français, tel Léon Roche, et anglais tel Richard Wood. Ces derniers souhaitaient en effet garantir les droits de leurs ressortissants en Tunisie. Toutefois, le pacte fondamental, soutenu par d’éminents réformateurs tunisiens, Kheireddine Pacha en tête, répond parfaitement au contexte sociétal de l’époque qui connaissait des tensions entre les différentes communautés religieuses.
Avancée majeure en termes de liberté, le Pacte fondamental ignore cependant toute règlementation relative à l’organisation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le successeur de Mohamed Bey, Sadok Bey dut donc y remédier et, pour ce faire, mit en place une commission chargée d’élaborer une constitution. Promulguée en 1861, après acceptation par l’empereur Napoléon III, la Constitution instaure des pouvoirs exécutif et législatif bicéphales. En effet, le pouvoir exécutif est partagé entre le Bey et un Premier Ministre tandis que le pouvoir législatif l’est entre le Bey et un Conseil suprême. La loi promulguée en vertu de cette Constitution était, conformément aux principes de territorialité déjà posés dans le Pacte fondamental, applicable aux étrangers présents sur le territoire beylical. Ceux-ci ne bénéficiaient donc plus des capitulations, ce qui provoqua de vives tensions diplomatiques avec les Etats européens désireux de conserver leurs privilèges sur ce point. L’article 9, peut-être plus que tout autre, démontre la nature progressiste de cette Constitution en ce qu’il dispose que le souverain qui violera volontairement les lois politiques du Royaume sera déchu de ses droits.
Tant le Pacte fondamental du 10 septembre 1857, que la Constitution du 26 Avril 1861, sont adaptés à la société tunisienne de l’époque. Le Pacte fondamental proclame l’égalité en droit entre sujets tunisiens musulmans et juifs pour mettre fin aux tensions religieuses tandis que la Constitution du 26 avril 1861 met fin aux capitulations en imposant le principe de territorialité de la loi. Si l’inspiration libérale des idéaux de la Révolution française de 1789 semble pour certains évidente, il n’en demeure pas moins que les deux textes se sont contentés de reprendre le principe de séparation des pouvoirs. Aucun recopiage pur et simple de droits étrangers, comme le décideront les chefs d’états arabes tout au long du XXème siècle, n’a été effectué. Certes, des conseils français et britanniques sont intervenus, mais c’est sous l’approbation sans réserves d’intellectuels et de notables que chacun de ces textes a été adopté.
La Constitution de 1861 ne fut cependant appliquée que trois ans avant que le Bey de Tunis n’y renonce. Confronté à une grave crise financière dans son royaume, le Bey sollicita l’aide des pays européens voisins qui exigèrent alors le retour des capitulations. Le souverain husseinite obtempéra. Ensuite, l’impopularité croissante du Premier Ministre Khaznadar poussa le Bey à suspendre le fonctionnement du Conseil. De facto, le pouvoir du souverain devint absolu, la Constitution inappliquée.
A ce stade déjà, on constate que le système de recopiage choisi par l’Empire ottoman a échoué, car inadapté. Ceci n’empêchera pas les pays arabes de reprendre cette méthode tout au long du XXème siècle.
II- Droits arabes des obligations, adjonctions française, allemande et locale
Au cours du XXème siècle, le droit des pays arabes s’élabore toujours par référence aux droits étrangers. Le droit des obligations le démontre davantage que tout autre. Deux hommes, deux juristes, dominent ce mouvement : Abd el Razzaq el Sanhouri et David Santillana.
En Égypte, la formation du droit des obligations est dominée par la personnalité d’el Sanhouri. Abd el Razzaq el Sanhouri, juriste égyptien, fit ses études de doctorat en droit à l’Université de Lyon dès 1921. Il assista donc aux grands débats doctrinaux opposant les tenants du nouveau Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), le Code civil allemand et ceux du Code civil français. Promulgué en 1896 et entré en vigueur en 1900, le BGB allemand est le premier code à sérieusement concurrencer le Code civil français tant du point de vue de ses qualités intrinsèques que de son rayonnement intellectuel. Si le Code napoléonien de 1804 est incontestablement l’œuvre juridique fondamentale du XIXème siècle, le BGB allemand est celle du début du XXème siècle. Épris de liberté, égalitaire, il pousse les juristes français à s’interroger quant à un éventuel renouveau du droit civil français. Ainsi, lorsqu’el Sanhoury a été nommé à la tête de la commission chargée de la rédaction du nouveau Code civil égyptien, c’est très logiquement que ce dernier s’est trouvé composé de dispositions du Code civil français et du BGB allemand. Ainsi, le nouveau Code civil égyptien fut promulgué en 1948. Ce code fut intégralement et fidèlement repris par la Lybie en 1953. En 1949, la Syrie, à son tour, promulgua un Code civil, copie conforme du Code civil égyptien puis par la suite l’Algérie en 1975 et le Koweït en 1980. Quant au royaume d’Irak, il sollicita el Sanhoury pour reprendre la forme et la méthode du Code civil égyptien en 1951. Enfin, on peut noter la prépondérance de l’influence du Code civil égyptien dans les codes du Bahreïn en 2001, du Yémen en 2002 et du Qatar en 2004.. Incontestablement, le Code civil égyptien d’el Sanhouri est celui qui a le plus influencé les codes arabes, qu’il ait été intégralement recopié ou adapté. Le Code civil tunisien, plus libéral, n’eut pas le même rayonnement quantitatif.
En Tunisie, la personnalité marquante est celle de David Santillana. En 1896, le Bey de Tunis Ali III décide de doter la Tunisie d’un Code civil. Son traducteur personnel, David Santillana, juriste italo-tunisien, eut la charge de diriger la commission devant élaborer un Code civil pour l’État beylical. Celui-ci, inspiré des législations française, allemande et suisse, entra en vigueur dès 1906 et fut fidèlement repris au Maroc en 1913, puis par la Mauritanie en 1980.
Les droits arabes de la responsabilité délictuelle, les inspirations française, allemande et locale.
A) La responsabilité du fait personnel
D’abord, le Code civil égyptien, promulgué en 1948 consacre en son article 163, un principe général de responsabilité du fait personnel, sur le modèle de l’article 1382 du Code civil français. L’article dispose que « toute faute qui cause un dommage à autrui oblige celui qui l’a commise à le réparer ». Ensuite, l’article 164 en son alinéa 1er subordonne la réparation au discernement, conformément au droit civil français. Cependant le second alinéa du même article dispose que, si l’auteur du dommage est privé de discernement, le juge pourra, en examinant sa situation financière, imposer une réparation en équité. Cet adossement de la réparation en fonction de la capacité financière de l’auteur du dommage est puisé dans le BGB allemand. Cela étant, si elle est en parfaite cohérence dans ce dernier, le serait-elle dans le Code civil français ? Ce dernier consacre en effet l’un de ses grands principes de responsabilité civile dans la réparation intégrale du préjudice subi. Or, dès lors que le montant de la réparation se mesure en fonction des capacités financières et non plus en fonction du montant du préjudice subi, le principe de la réparation n’est plus celui de la réparation intégrale. Certes, dans le Code civil égyptien, l’absence de réparation intégrale ne concernera que l’auteur de dommage dépourvu de discernement. Cela étant, l’absence de discernement chez l’auteur d’un dommage est loin d’être un cas d’espèce. Aussi l’inspiration très majoritaire du droit français de la responsabilité civile, construit autour de la réparation intégrale du préjudice, en s’écartant de ce principe fondamental ne semble pas des plus pertinentes.
Quant au Code tunisien, en son article 82, il s’est contenté de reprendre l’article 1382 du Code civil français qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe ». Il est nécessaire de noter que le dommage moral est discuté en droit musulman[2]. Cela n’oblige aucunement les citoyens musulmans à ne pas demander la réparation d’un préjudice moral s’ils la jugent contraire à leur conviction religieuse.
B) La responsabilité du fait d’autrui
Le droit égyptien de la responsabilité du fait d’autrui est formé par l’adjonction de plusieurs droits. L’article 174 du Code civil égyptien reprend la solution française qui consacre la responsabilité du commettant du fait de leur préposé dans l’exercice de leur fonction. L’article 173 al. 1er qui instaure la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est un copier-coller de l’article 832 du BGB allemand. Les seuls ajouts au droit allemand se trouvent dans le second alinéa de l’article 173 du Code civil égyptien qui dispose que le mineur est réputé avoir besoin de surveillance jusqu’à l’âge de 15 ans ou encore que le mari est responsable du fait de son épouse mineure (coutume locale de l’époque) et dans le troisième alinéa qui reprend le fondement français de la responsabilité des parents du fait de leur enfant, une responsabilité fondée sur la présomption de faute des parents dans la surveillance de leur enfant. C’est une reprise du droit français en vigueur jusqu’au revirement de la Cour de cassation française de 1997 par le fameux arrêt Bertrand[3]. BGB allemand, Code civil français et droit coutumier réunit en un seul article. Existe-t-il une cohérence entre ces trois droits ? Du reste, ont-ils la même ratio legis ? Au demeurant, l’ajout de ce second alinéa était-il utile? En effet, rien n’empêche, en absence de second alinéa, le citoyen égyptien désireux de respecter les coutumes locales d’être responsable du fait de son épouse mineure s’il le souhaite.
C) La responsabilité du fait des choses
La responsabilité du fait des choses est elle aussi issue du droit français, plus précisément de l’article 1384 alinéa 1er et du premier arrêt Jand’heur[4]. En effet, si l’article 178 du Code civil égyptien consacre une responsabilité de plein droit du fait des choses, il ne s’agit que des choses exigeant une surveillance particulière ou mécaniques et non pas, comme l’a posé le second arrêt Jand’heur[5], de toutes les choses. Dans les travaux préparatoires du Code civil égyptien, el Sanhouri justifie ce choix en raison de la différence d’industrialisation entre la France et l’Égypte. Le droit tunisien reprend aussi le droit français de la responsabilité du fait des choses mais en s’en écartant dans une certaine mesure. Ainsi l’article 96 du Code des obligations et des contrats tunisien, s’il reprend l’article 1384 al 1er, admet une cause d’exonération dans la démonstration de l’absence de faute et s’écarte là encore de conceptions globales – la réparation intégrale et la responsabilité objective – du droit français dont il est principalement issu.
Ces incohérences multiples ne sont pas uniquement dues à la volonté politique de s’approprier les droits étrangers en les mêlant aux coutumes locales, mais également à l’absence de questionnement relatif à la ratio legis.
III- L’inexistant questionnement de la ratio legis
Si un droit étranger apparait si performant, si complet, si profitable, pourquoi ne devrait-il pas être intégralement repris ?
Une condition, plus que toutes les autres, doit être respectée. D’un pays à un autre, s’agit-il de la même ratio legis ? Autrement dit, la raison d’être des législations européennes est-elle la même que celle des pays arabes ? Ce questionnement a des conséquences plus vastes que la simple adoption législative ponctuelle. La ratio legis est le fruit d’une orientation sociétale. Le Code civil français de 1804 a été adopté pour bâtir un pays avant tout égalitaire et laïc. Le Bürgerliches Gesetzbuch de 1896, pour construire une société libérale, consacrant avec force l’autonomie de la volonté. Ce questionnement est d’autant plus important qu’une société, qu’elle soit égalitaire, laïque, libérale, conservatrice, très religieuse sera amenée à évoluer. Son droit doit accompagner cette évolution. Ne pas s’interroger sur la ratio legis, parce que le droit est d’inspiration religieuse ou étrangère, c’est prendre le risque d’adopter un droit inapte à accompagner les évolutions sociétales.
Ce questionnement de la ratio legis ne semble pas avoir été effectué en profondeur dans les pays arabes, exception faite des travaux préparatoire d’el Sanhouri en Égypte. La conséquence directe est un droit composite formé de droits étrangers estimés modernes et de droit coutumier.
Ce questionnement n’est a priori guère compliqué. Un premier constat : depuis près de deux siècles, les sociétés arabes sont dans l’attente de réformes modernisatrices. Les volontés d’appropriation des droits étrangers jugés modernes en témoignent. Les coutumes locales voire religieuses sont parfois perçues comme un frein à cette modernité. Cette idée est fausse. Les coutumes locales, y compris religieuses n’empêchent pas, en elles-mêmes, un Etat – dont la population est profondément attachée à sa religion comme socle sociétal – d’adopter un droit moderne et adapté. Trop souvent le droit étranger, voire la modernité elle-même, apparaît inadapté par nature, puis adapté par adjonction du droit religieux. Le Code du statut personnel adopté par Habib Bourguiba, très moderne, fut parfaitement intégré au nouvel Etat tunisien. Le fondateur de la Tunisie moderne s’est attaché à questionner la ratio legis : quel droit pour la société tunisienne ?
Si les volontés actuelles des pays arabes, au regard des récents bouleversements politiques, manifestent un désir profond d’embrasser la modernité tout en restant attachés au socle sociétal que représente la religion, alors le droit ne peut être pensé en opposition au fait religieux. En pareil cas, il sera rejeté, voire combattu. Il doit être pensé en dehors du fait religieux, de sorte qu’il n’y prendra même pas part. Le fait religieux en lui-même ne doit pas être mis en équation lorsqu’il s’agit de penser la ratio legis. En revanche, pour assurer son épanouissement, la garantie qu’il sera à la discrétion totale des citoyens doit être assurée. Une fois cette réflexion faite, celle concernant la raison d’être d’un droit moderne, attractif, voire réformateur pourra être menée.
En guise de conclusion, une question apparait essentielle. Le législateur étatique doit-il légiférer pour faire respecter les croyances religieuses de sa population ou adopter des lois libérales n’imposant aucune contrainte quant à sa pratique religieuse ? Ainsi, les lois libérales n’imposent aucune contrainte et permettent une pratique religieuse laissée à la discrétion des citoyens. Encore une fois, l’époux qui souhaite, conformément à certaine coutumes locales, être responsable du fait de son épouse mineure, est libre de réparer le dommage causé par celle-ci, de même que la permission légale de divorcer n’oblige pas les citoyens chrétiens à divorcer.
Comme le remarque Monsieur le Professeur Ali Mezghani « la foi n’est pas menacée dans son existence lorsque l’autorité religieuse, ou ceux qui s’y sont substitués, est appelée à renoncer à sa prétention de régenter, dans tous ses détails, la vie en société. Aucune foi n’est menacée par la mise en œuvre réelle de la liberté de conscience et de l’égalité entre les hommes. »[6]
C’est ainsi que le droit des pays arabes n’a pas à être ni inspiré des droits européens pour être moderne, ni des coutumes locales religieuses pour, dans le même temps, garantir la foi des citoyens. Un droit ne comportant aucune référence religieuse n’empêche en rien la pratique religieuse. Pour être plus précis, un droit étatique séculier et libéral laisse toute latitude au droit religieux quant à sa pratique puisqu’il n’impose aucun interdit, quel qu’il soit, aux citoyens. Ces derniers auront alors toute latitude dans leur pratique religieuse.
« Sécularisé, le droit est un fait culturel et appartient aux hommes. Fait de société, il peut s’adapter à ses évolutions et même les susciter. Un droit religieux, en revanche, lui est extérieur; il est spécifique à un groupe particulier, ne pouvant être égalitaire, puisqu’il n’est pas commun à tous les citoyens. »[7]
Mehdi Alharrak
[1] Par coutumes locales nous désignons les traditions religieuses – dans leur pluralité – liées aux habitudes locales
[2] Cf. Ali Kazemi-Rached, L’islam et la séparation du préjudice moral, Genève, Droz, 1990, 148 pages
[3] Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1997
[4] Civ2 21 février 1927
[5] Cass, Ch réunies, 13 février 1930
[6] MEZGHANI Ali, l’Etat inachevé, NRF, 2011, p 314
[7] Ibid., p 238